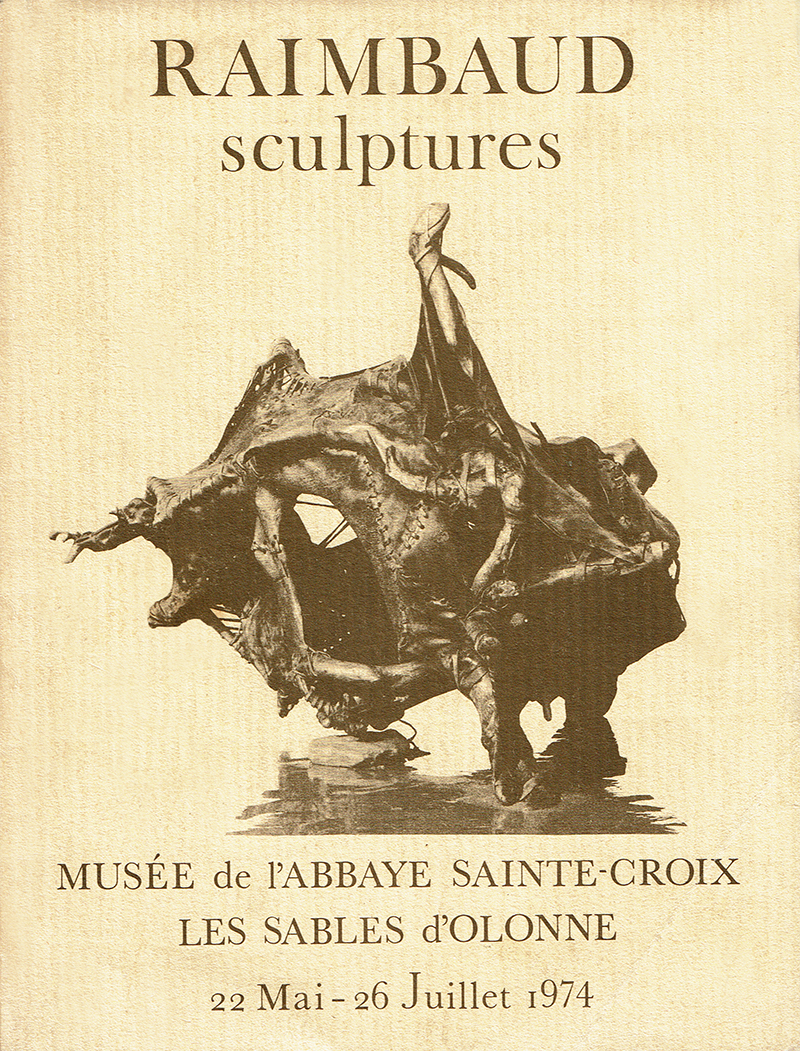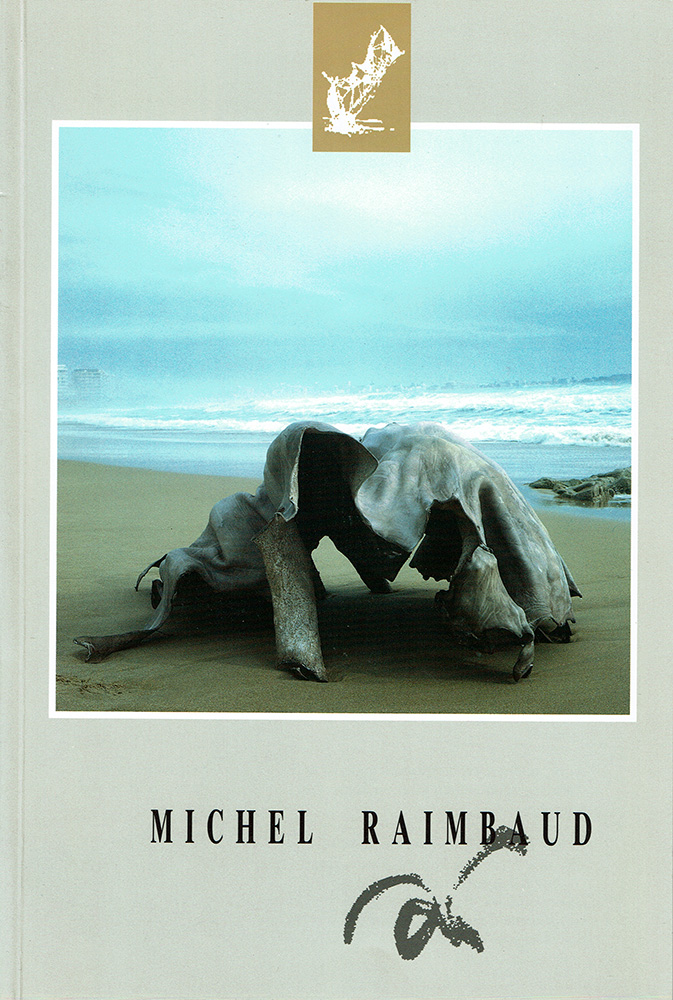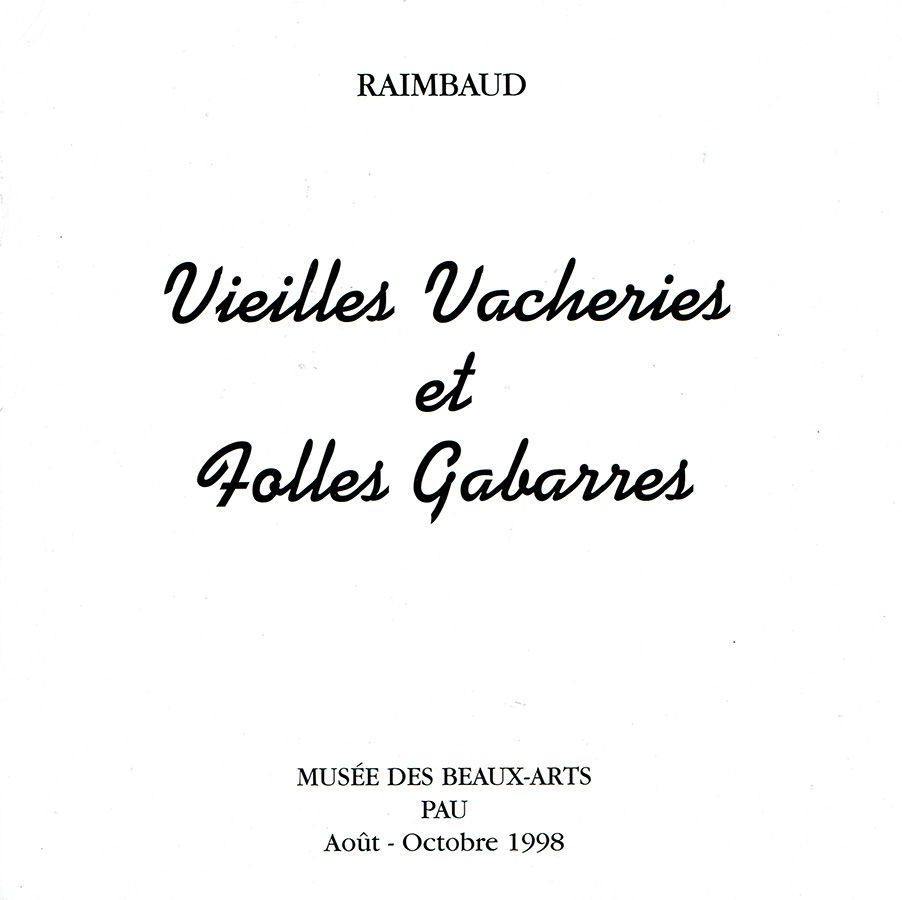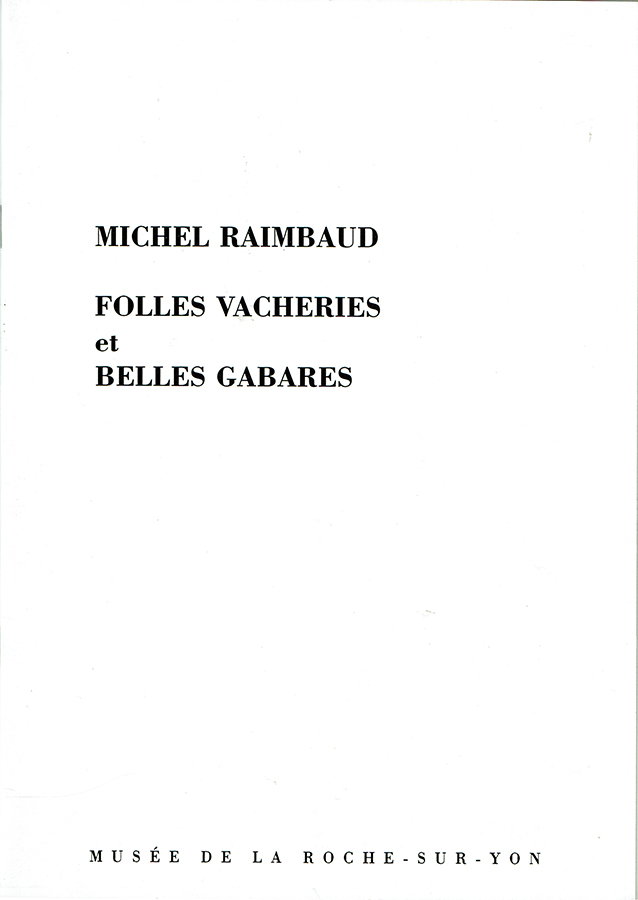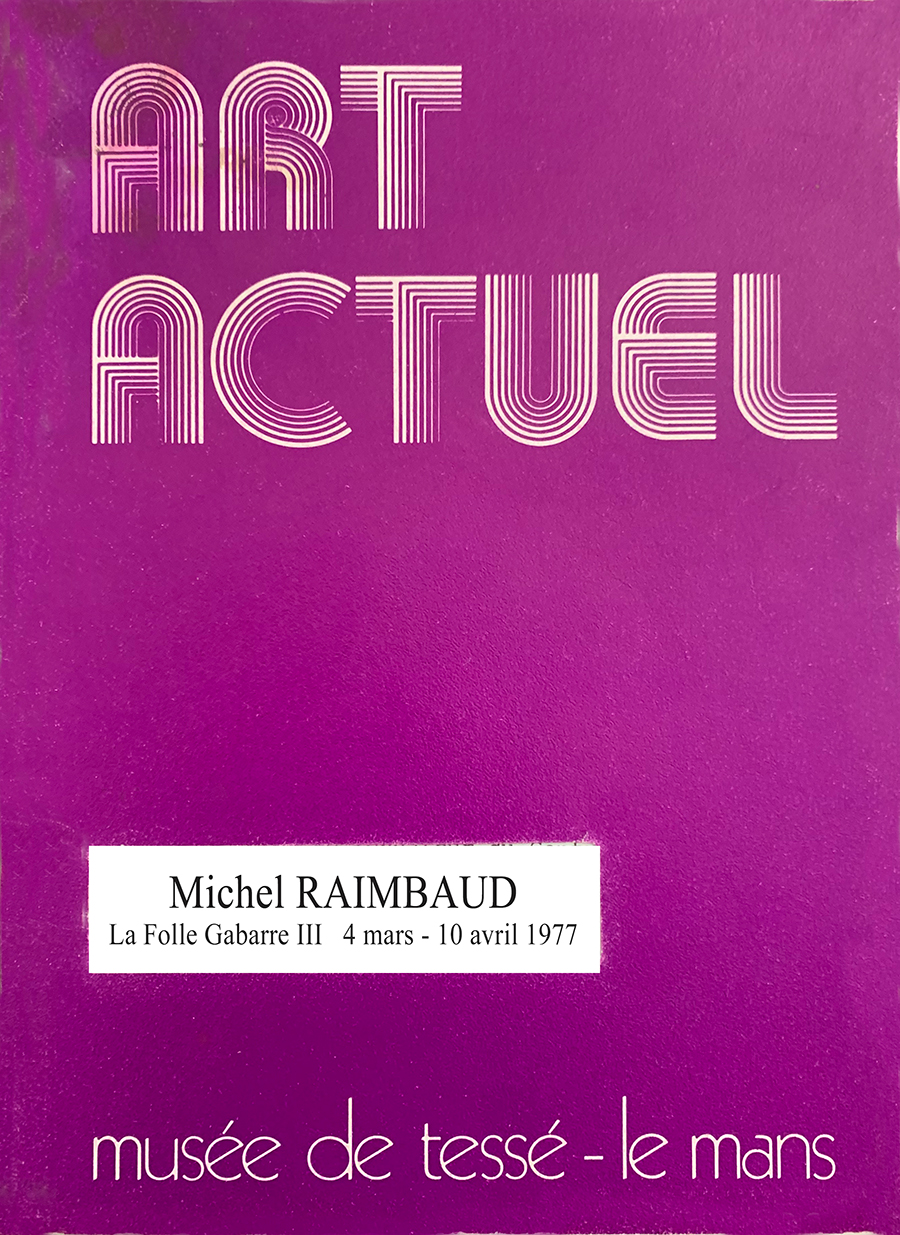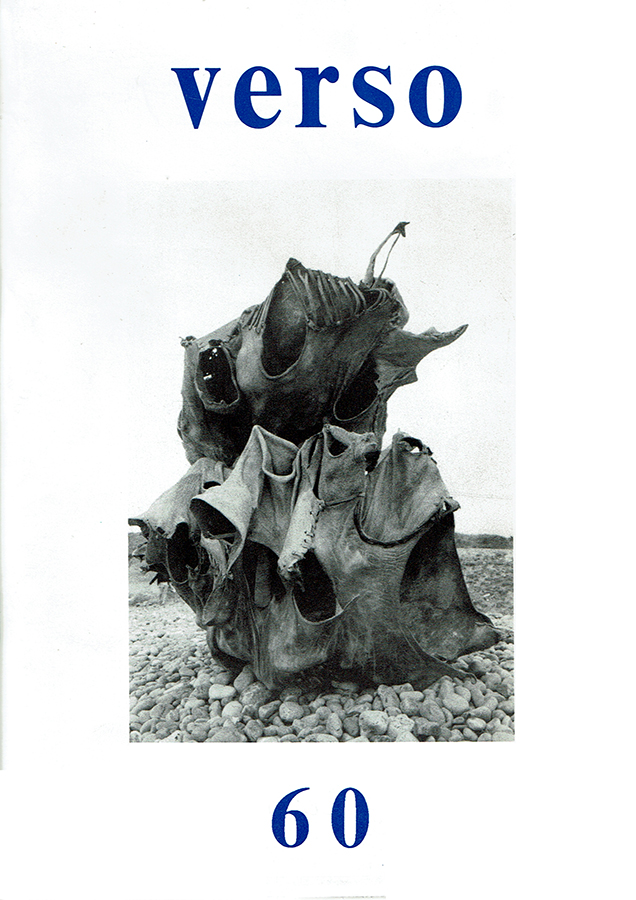ÉCRITS
Textes / Témoignages / Préfaces
RAIMBAUD sculptures
Musée de l’Abbaye Sainte-Croix – Les Sables d’Olonne
Mai – Juillet 1974
Textes : Droits réservés.
Suzanne de Coninck - Avril 1974
« Merci pour le spectacle d’un enfant comblé » écrit en juin 1973, Corinne, cette jeune inconnue qui avait observé un petit garçon pour qui La Gargamoëlle exposée au Salon de la Jeune Sculpture dans les Jardins du Luxembourg avait révélé d’un seul coup le monde physique et celui du rêve.
Cette Gargamoëlle, œuvre maîtresse à cette date du sculpteur vendéen, Michel Raimbaud (républicain de 1793, issu d’un ancêtre bonapartiste, d’une sage et bonne grand’mère paysanne, d’un père ébéniste du Faubourg Saint-Antoine, gradé commandant, professeur de dessin, chercheur alchimique), avait su toucher les fibres les plus sensibles d’un enfant. Et cela me rappelle sur un tout autre plan ce que me racontait Brancusi qui avait vu une jeune femme agenouillée, en larmes, devant la Muse Endormie et pour qui ce moment vécu avait signifié bien davantage que tous les hommages qui lui furent rendus. Certes, ce ne sont pas des correspondances de style qui unissent Raimbaud à Brancusi, ils représentent même deux pôles de la sculpture (il n’y en a que trop qui cherchent encore ce que Brancusi a trouvé au début du siècle), mais bien un même sens du jeu, un même humour face à la création et à l’homme tout court. Imagination, plaisir, jeu, fantaisie ne signifient ni superficialité, ni manque de sérieux, mais bien « dépassement ». Dépassement du quotidien, de la banalité, de la convention qui nous tend constamment ses pièges insidieux et revenant à la Gargamoëlle, œuvre libre et généreuse, ivre de vitalité à la fois sauvage et tendre et à laquelle songeait Raimbaud depuis 1965. Elle vivait en lui à travers ses premières œuvres encore marquées par une tradition picturale (le châssis, le tube de couleurs, etc.) tel ce tableau de chevalet de 1965, Epave du Pleni qui semble vouloir éclater, sortir de cette mesure fixe de la toile, qui cherche le relief, la construction explosée, ou la Paire initiale de mai 1968 qui fut sa dernière peinture sur peau de vache, de cul de chalut (1) griffée, lacérée, brûlée, où la couleur n’est plus que vestige d’une tradition qui se meurt, œuvre à la fois tellurique et aquatique que serpente la Wouivre Raimbaud ne connaissait pas encore sa vocation majeure : la sculpture. Il y pensait mais ne savait comment l’appréhender et c’est ainsi que de dessinateur et de peintre accomplis, il tente de nouvelles expériences.
Dans Plaisir d’Amour d’automne 1968, ce relief mural, cousu de lanières étroites, rapiécé, il introduit, goguenard et douloureux, des outres vides en peau de bique rejetées par la mer après le naufrage du Pleni en 1965 et qui deviennent signes sexuels. Michel Raimbaud toujours appelé par la sculpture veut ensuite utiliser le bronze et ce sera Blessure comblée. Mais cette solution ne le satisfait guère et il reprend le travail de plus en plus en volume de ses peaux de vache avec la Vieille Véruse de 1969 (expression chaumoise signifiant vieille vérole) qui est à la fois une œuvre paillarde et joyeuse. Avec sa tête de cheval, qui se débride dans une Apocalypse des Temps Modernes, en bois, en peau, unis, confondus en une alchimie consciente. La Honra, de l’été 1970, en cuir, noircie par le feu signifiant la force du taureau ou du joug, telle un Christ noir d’Espagne, gloire dure à porter sur les épaules ou sur la tête et la Cahouenne vorace de 1970 ou Ténéré (la Mort), cet alliage d’une putain et d’un crabe qui n’est pas sans rappeler les images fantastiques de Jérôme Bosch. La peau durcie, rongée par les brûlures du soleil, semblable au sable du désert reçoit dans son sein desséché cette carcasse insectéiforme qui bientôt ne sera plus elle-même que sable. Conçue pendant la guerre civile en Palestine où les êtres assoiffés luttaient contre la mort toujours présente, Raimbaud nourrit son œuvre d’éléments pensés vécus, de symboles, d’accents graves, déchirants, dérisoires qui nous prennent à la gorge telles des visions dantesques.
Cette dernière œuvre clôt la période des reliefs sur châssis. Elle est à la charnière d’une renaissance, d’une « Mue » comme s’intitulera d’ailleurs une œuvre postérieure. Le créateur trouve sa voie et enfin libéré de toutes conventions plastiques, chargé d’un poids de connaissances qu’il peut transcender, il pénètre un monde subtil, encore inexploré et découvre cette cosmogonie du « rêve plein » qui ne peut plus trouver son expression que dans des formes aériennes, au début encore enracinées pour se dégager ensuite définitivement dans la Garache blanche et Folle Gabarre. Même dans l’Oiseau mort (août 1971), première sculpture totale composée de cuir devenant du bois, l’élan, l’échappement apparaît déjà. On entend ce cri, cet appel vers un envol devenu apparemment impossible mais qui est l’essence même de la substance, de la vie de l’oiseau.
Béluga, de 1971 (septembre), sorte de poisson monstre, est le contrepoint de l’œuvre précédente. C’est la dualité, l’unité de l’eau, de l’air qui animent la création du sculpteur. Rivés à la terre par leur peau périssable, maintenus par le bois de leurs os puissants ou fragiles, leur appartenance à l’air, à l’eau n’est qu’intention éphémère et Raimbaud traduit ces accords discordants dans un langage à la fois vertébré, musclé, musical dont les titres imposent leur rythme unique.
Le Reître écorché ou le Grenadier des Flandres de l’hiver 1971-72, qui, vu de dos est un poisson laisse échapper d’une gueule cassée un hurlement ultime, un chant de gloire et de mort, les yeux vides et vivants à la fois, au-delà de la vue terrestre, les côtes figurées par des lanières cousues, le sexe dressé telle une corne. Belphégor de novembre 1971, œuvre totémique de bois et de peau cousue, appel magique de l’être enfermé dans son enveloppe étroite, resserrée, ne laissant qu’aux yeux un passage de lumière. Mue (automne – hiver 1973) est en effet un passage, une transition, un accès vers l’époque blanche, vers la maison qui sera à la fois protection et possibilité de départ. L’œuvre d’un seul morceau de bois finement poncé, sculpture par gaînage d’une peau, devient animal. Elle s’élance. D’elle naîtront la Gargamoëlle puis la Garache blanche.
L’Enfant de décembre 1973 fera partie du Cri de la Mère, œuvre où le cuir signifie seulement les liens qui unissent l’enfant à la mère. La tension de la naissance provoquant le cri d’angoisse de la mère pour l’enfant. Cette dernière attache à la terre trouve une correspondance dans le Mur du Père d’avril 1974, l’enfant à la fois ligoté au père et repoussé en avant ne peut se libérer qu’en brisant ses liens.
La Garache blanche (la vache blanche), œuvre antérieure de mars 1974, ramassée sur la grève des Sables dans cet entonnoir de Cayola, riche en épaves, où, dit la légende, Richard Cœur de Lion, roi d’ Angleterre vint au pays de sa mère frapper monnaie et qui fut le théâtre de tant de rencontres et batailles princières entre la France et l’Angleterre. Cette garache tricéphale et tripode, à la fois magique, animale, rustique, féerique, hantait les campagnes de l’Ouest, la nuit. Dans la mythologie celtique oubliée, était-ce une fée ? une dame blanche ? un menhir sous la lune ou la barque irlandaise issue de la légende ? Cette garache blanche, sorte d’Œuvre au Blanc, paraît immatérielle, cette vache pourrait s’envoler et retrouver son essence première en compagnie d’autres vaches sacrées de l’Inde éternelle ou de l’Egypte. Encore rivée à la terre par les lois de la pesanteur, elle pourrait partir avec Folle Gabarre (avril-mai 1974), bateau ivre, vaisseau fantôme. « Vésoualle, ça va-t-y farguer de Mine ? ! (2). Œuvre funambulesque composée de six flancs de taureaux, trois peaux entières en étendard, des bois blancs qui partent dans tous les sens. Un oiseau, un arbre, un bateau, un aéroplane, un grand coup de vent tout ensemble pour chasser les pollutions – vive le grand large et le grand largue. Reprenant ainsi la description qu’en fit Raimbaud lui-même, je l’associe dans mon imagination à la Gargamoëlle dont un arbre entier constitue l’ossature, lieu de repos et d’évasion, plein de trouées de lumière, qui de l’intérieur protège et, chevauchée, ensorcelle, entraîne au voyage alchimique. Alors que Folle Gabarre n’est plus que départ sauvage, liberté poétique, voyage lumineux vers les sublimations et les inconnues, toutes voiles aux vents.
Ce qui signale l’œuvre de Raimbaud dans le contexte de la sculpture actuelle, c’est son appartenance absolue à la Poésie. Chaque ligne, chaque mouvement, chaque volume indiqué ou surgissant est une des phrases d’un poème dont la gravité rejoint l’épopée et dont la surprenante légèreté des masses, des nœuds, des éclats a ses sources dans une fabuleuse satire.
D’où lyrisme, lyrisme créateur de toutes pièces d’un univers volant, soufflant, se cabrant, se déchirant, rompant les amarres d’un bateau ivre né au sein de la terre chaude, naviguant sur une mer houleuse ou calme, celle de la côte sauvage de Vendée qui a nourri l’âme de feu de Raimbaud.
Telles des images de « l’espace heureux » pour reprendre la terminologie bachelardienne qui s’adapte si bien à l’œuvre de Raimbaud, ses dernières œuvres, de la Gargamoëlle à Folle Gabarre, en passant par Mue et la Garache blanche sont une cosmogonie de la maison raimbaldienne. « La maison comme le feu, comme l’eau permet d’évoquer des lueurs, des rêveries qui éclairent la synthèse de l’immémorial et du souvenir » (3). Cette fixation du bonheur, Raimbaud y renonce ou cherche davantage. Sa maison terrestre explose pour devenir navire spatial. Elle vogue et vole sans contrainte avec son contenu de bois, de peaux solidement couturées, nouées, avec son contenu de Vie.
Suzanne de CONINCK
avril 1974.
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
1. Peau de vache : carré de peau qui protège le fond de la drague de chanvre, le chalut, de la déchirure des coquilles et des roches, jeté par les marins quand il devient inutilisable.
2. « Bon sang, ça a-t-il de l’ailure » !
3. Gaston Bachelard, la poétique de l’espace – P.U.F.
Claude Fournet
Matériaux : le bois, le cuir (l’os et la peau), non pas mêlés (dans un corps), mais noués (et en cela objet de la représentation du corps). Corps qui n’est plus le corps (dont le geste ne se dénoue pas) mais serré un peu plus fort, ligaturé (cousu) – torturé même.
Donc une scène de formes ( entendre les « bois flottés ») doublée d’une autre scène (entendre les « peaux »), où l’os serait l’organe et la peau la cloison : lieu d’une reconduction d’objets abandonnés dans l’usure de l’élémentaire (la mer) vers un repli terrestre – lieu fœtal, couturé, d’une naissance rapiécée, tragique.
Un détournement surtout : celui, théâtral, d’une mise en scène (entendre plutôt d’un « éclairage ») qui modifie la fonction : le bois, la peau traités (comme fossilisés) dans une autre patrie (que celle de la mer), pour un autre corps (plus dense) mais représentable, désignant, sculptural au sens où il se détache, en exergue de la réalité, où il ne s’insère pas. Lieu des ligatures ou d’une préhistoire des chirurgies ou encore d’une réanimation symbolique (projet toujours mythique de la sculpture d’insuffler la vie, de recréer le vivant). De l’anamorphose de l’instrumentation jusqu’au méconnaissable (la naissance et la mort mêlées) des séries contradictoires, plurielles, qui ne signifient que le fait d’être simplement là – et d’autant plus que leur histoire ne désigne (d’un passé) que le colmatage incessant du mortel.
Claude FOURNET,
Conservateur du Musée de l’Abbaye Sainte-Croix des Sables-d’Olonne.
Denys Chevalier
D’où vient que les œuvres de Raimbaud, ce bourrelier de génie truculent et savoureux, plus que destinées à l’univers soigneusement calfeutré d’une collection, me semblent faites, avant tout, pour une étroite insertion dans le monde des formes naturelles, parmi les herbes folles, les cailloux, les fleurs sauvages ? Comme si les problèmes de l’intégration à l’environnement s’y trouveraient résolus d’une tellement adéquate façon qu’on pourrait les prétendre ne s’être jamais posés.
Serait-ce à cause de ces merveilleuses photographies qui les montrent sur fond de plage, à marée basse, avec horizon marin à perte de vue, ciels et eaux confondus ? Ou à cause de ce vide incomblable, irréparable, qu’a laissé dans le jardin du Luxembourg, à Paris, cette Gargamoëlle aux Oyseaux aujourd’hui redevenue vendéenne mais qui fut, l’instant d’un printemps, lieu privilégié de ferveur poétique, jeu propice aux connivences enfantines et délectation d’un jury qui lui décerna son prix ? À ce propos, et cela soit dit sans offenser les précédents lauréats, faut-il convenir que rarement distinction fut aussi incontestablement méritée.
Quoi qu’il en soit, bien plutôt pensè-je que ce qui vient de la nature, co-signataire en somme, doit, sinon obligatoirement lui retourner, du moins ne pas en être arbitrairement isolé et que ce qui fut réalisé avec sa collaboration ne peut lui être soustrait. En effet, de constitution complexe correspondant à la mixité de leur élaboration, ces peaux et bois ressortissent à l’ambiguïté fondamentale de la réalité. Ni tout à fait ce qu’ils semblent être, ni tout à fait autre chose et, en tout cas, bien davantage que leur apparence. Assemblages ou collages dans l’espace, par cordonnerie presque, évidemment, mais encore créations plastiques. Fictions, pour ainsi dire.
Toutefois, mieux les vois-je comme signes, bornes milliaires au long des obscurs cheminements de la mémoire, emblèmes. Mais de quels événements inconnus, à venir ou oubliés ? Car ces cryptes, ces grottes, ne sauraient être qu’antres pour animaux fouisseurs et ces formes totémiques ou phalliques que simples perchoirs pour ·oiseaux, même mythologiques. Pas plus que cavernes du pirate ou d’Ali Baba. Non, un autre trésor, infiniment plus précieux, gît en ces coffres ; l’enfance, très précisément l’enfance retrouvée dont le sésame, à ceux que marque la grâce, ne se révélera que par la clef de l’imagination dans la serrure du souvenir.
Du reste, les marmots ne s’y trompent point, si peuvent se leurrer les adultes oublieux de ce qu’ils furent. Eux sont de plain-pied avec cette symbolique à la mesure de leur fantaisie. Elle figure leur présent dans toute la somptueuse équivoque du terme, à la fois offrande et maintenant. Au surplus, c’est un peu de semblable manière que, dans son art, je soupçonne Raimbaud de procéder, par sélections plus ou moins consciemment motivées, par liberté d’interprétation allégorique, par associations d’idées ou mieux, de formes.
Cependant si la sélection ne s’exerce que sur les bois, ais de carènes, fermes de charpentes, branches roulées par les flots ou autres (fournitures objectives du hasard dans le même temps que choix très subjectifs) ses répercussions plastiques ne s’en étendent pas moins jusqu’aux peausseries et aux crépins du revêtement. En effet, soutenant, supportant et architecturant celui-là par en dessous et en dedans, ces témoins du bonheur de la trouvaille en constituent l’armature intime, l’explication, le prétexte formel indispensable. Aussi bien, encore que présidant à la recherche de ce prétexte, le fortuit et l’accidentel ne laissent pas d’être sévèrement passés au crible de l’évaluation des possibles expressifs qu’ils recèlent. Ainsi, pour Raimbaud, entre dix morphologies proposées par le hasard, toute la question reste de discerner laquelle, en se combinant avec d’autres déjà définies ou encore à déterminer, accédera à sa pleine signification au sein d’une œuvre unique et homogène.
Mi-végétaux malgré l’érosion ou la corrosion du flottement des bois, mi-organiques malgré la désincarnation des cuirs manufacturés, les totems et cavernes de l’artiste sont à la fois métamorphoses de la nature et créations concertées. Mais autant des premières que des secondes il doit être tenu pour responsable car son intervention opère sur un double niveau ou, plus exactement, se manifeste dans deux registres, sélectif et optionnel pour les structures internes, délibéré et formulateur pour les plans épidermiques. Au travers de ceux-là, les cuirs, enveloppes charnelles actualisantes, se devine ou se pressent l’étrangeté des bois avec leur poids spécifique et cette présence du passé que ni le temps ni les intempéries n’abolissent.
Même quand son matériau fut enrichi par d’autres hommes, qui vinrent avant lui et dont s’identifient encore les traces en partie effacées, son invention reste entière et personnelle, au deuxième degré peut-être, mais tout aussi singulière. Ainsi, au terme d’une magique entreprise de transubstantiation (bois et cuirs devenant matériaux commémoratifs et mémoriaux d’un temps lyriquement, voire épiquement, retrouvé) sa sculpture naît-elle à l’espace un peu comme s’édifiaient temples et palais d’un célèbre facteur, par insinuation, capillarité, osmose.
Pourtant le péril est grand, avec de telles conceptions et méthodes, de chuter dans l’amateurisme ou l’autodidactisme, portes ouvertes aux pires démissions. Or rien de pareil ne se produit chez Raimbaud dont les plus exaltantes motivations poétiques ou les plus extraordinaires conjugaisons de volumes et matières demeurent toujours fermement fondées sur une constante lucidité non dépourvue d’une sorte d’humour malicieux et dru, rural presque.
Pas davantage piraterie dans son appropriation ou mieux, récupération. Complicité pré-voyante plutôt. Et effusion panique. Sinon familier des elfes des prairies ou des-feux follets des marécages, en effet, du moins à leur instar, le sculpteur (Rik Bald, puissant et hardi en théotisque) ne converserait-il pas, en secret, avec Mélusine et Merddhyn, ces tutélaires gardiens du mystère ? Hypothèse nullement extravagante à mes yeux puisque dans la lignée de Rabelais par la verve et le pittoresque de l’expression bien plus proche du conteur de la Jument Verte et du bouif de Vix que de tel rimailleur au populacier conformisme pour plombier-zingueur ou tel entourloupeur de l’art brut, il me semble appartenir à cette humanité prédestinée sur le berceau de laquelle de bonnes fées se penchèrent et que son habileté à capter le langage des sources, à faire éclore charmes et enchantements, comme aussi à lire les présages, a marqué du signe des élus. Coiffé m’apparaît-il.
Denys CHEVALIER
Témoignages et entretiens
Cahiers de l’Abbaye Sainte-Croix n°99
Textes : Droits réservés.
Noblesse du déchet - Benoît Decron
L’exposition consacrée à Michel Raimbaud est une rétrospective en trompe-l’œil, ne rendant compte que partiellement d’un travail riche, étalé sur près de quarante ans. Beaucoup d’œuvres ont disparu, en particulier, les Folles Gabares, constructions éphémères – on en a dénombré 32 – et quelques commandes publiques ; les 1 % des écoles sont toutefois menacés par les précautions sécuritaires de Bruxelles et d’ailleurs. Un pan social de l’œuvre de Raimbaud, mêlant jeu et imaginaire, manque indéniablement. Chacun, aux Sables d’Olonne, se souvient des Folles Gabares installées sur la grande plage et sur celle de Tanchet (en 1978 et 1977). Dans un avant-projet pour la Florentine, gabare qu’il dressa dans la cour de l’école de Saint-Florent‑des‑Bois, Raimbaud glissait : « La Gabare fonctionne immédiatement partout (plage, parc, école) comme cabane de rêve, hutte forestière, voyage de navire, ébats sportifs. On y grimpe, on domine (les adultes), on saute, glisse, on se blottit dans les hamacs comme dans un nid, on s’abrite sous les auvents de cuir, on est au vent, ou sous le vent des voiles, à l’ombre, à la lumière, on y reconstruit des histoires fabuleuses1 ». En premier lieu, l’artiste mêlait la métaphore maritime et celle, terrienne et campagnarde, de la charrette : cette conception prévaudra pour les gabares. Ensuite, il soulignait la dimension éducative et ludique des constructions dont le matériau spécifique, la peau tannée, muait en matrice ou en nacelle protectrice. En 1998, lors du spectacle, la Nef des Fols, le corps en mouvement des danseurs, en s’emparant des carapaces durcies de peaux de vache, rendra plus manifeste cette idée d’enveloppe2. Endosser ou s’échapper.
On ne soulignera jamais assez le rôle capital des photographes, comme accompagnateurs, complices, de l’œuvre de Michel Raimbaud. En participant, sur les plages, à la mise en scène de pièces de toute taille, maquettes ou installations, ils ont fait plus que documenter. Leurs clichés rendaient une esthétique du moment. Au milieu des années 70, Raimbaud travaillait avec Yves Lemasson, installant sur les grèves luisantes ses sculptures tendues, cousues de cuir de cul de chalut. Depuis Rodin, le noir et blanc a coïncidé avec la prise de vue des sculptures, idée relayée par Lucien Ciergue avec sa série Née de la vague3. Le photographe tentait de concilier le paysage naturel et la statuaire, de les confondre dans une ambiguïté organique, somme toute, de dévoiler leur profonde osmose4. La mise en scène, plus ou moins élaborée selon la nature de l’oeuvre, épousait le paysage côtier: c’est le cas pour les oeuvres polychromes de la fin des années 70, les Bois rouges ou bleus ; ces compositions exigeaient l’usage de la couleur. Richard Long, Robert Smithson, plus tard ils Udo ou Andy Goldsworthy enregistrèrent leurs installations par la photographie, dans un esprit purement conceptuel, comme « trace mnémonique »5 . L’image mentale domine et rend l’objet accessoire.
Pour installer l’œuvre de Raimbaud dans le flux haché de l’histoire de l’art, il faut en extraire les traits originaux. De ses desseins primitifs, de son parcours de sculpteur dans un milieu voué à la peinture, nous dégagerons les lignes de faîte6.
Peintre et professeur de dessin, Raimbaud arrivait aux Sables d’Olonne en 1958 : il peignait alors des paysages d’arbres et d’épaves, dans un style proche de l’abstraction en vogue à Paris. Son Naufrage du Pléni présentait la coque éventrée d’un bateau échoué avec ses membrures de bois, ses ferrailles dressées, comme une vision prémonitoire des reliefs à venir7. Arpentant les plages de Cayola et de la Mine, Raimbaud repérait et collectait les bois flottés. Il les associa aux cuirs de cul de chalut réformés par les marins pour faire des panneaux muraux, plutôt des tableaux gonflés et éviscérés (Cahouenne vorace, 1970). S’il ne rompait pas pour autant avec le plan du tableau, l’irruption des trois dimensions semblait fatale. Avec La Gargamoëlle aux oyseaux, prix de la Jeune Sculpture en 1973, il marquait avec succès son passage à la sculpture. Cette Gargamoëlle, vaisseau osseux tendu de cuir encaustiqué, exprimait une nouveauté dont on peinait à affirmer la nature : « Cabane, calèche, nacelle, cœur, gésier », selon l’artiste. Structure habitable et suspendue, conçue pour le dedans et le dehors, on pouvait y voir une architecture fantasque comme une sculpture sans socle. Un an plus tard, au Salon de Mai, la première Folle Gabare, posée sur les marches du Trocadéro, radicalisait sa pensée : élan des mâts et des vergues, peaux accrochées en nappes, haubanage dense, verticalité en dégradé…8 Rompant avec « l’aplomb normalisé continental »9, il n’était pas un sculpteur convenu : parce qu’il utilisait le cuir, un matériau aux marges, parce qu’il travaillait en dehors de l’atelier, parce qu’il participait, lui aussi, au mouvement d’éclatement spatial, après Gargallo, après Lipchitz, après Pevsner. Dans toutes ses créations, l’artiste n’oublia jamais les principes fondamentaux inspirés par les précurseurs.
Raimbaud était indissociablement lié au cuir, à la peau, fleur et déchet. Il n’y a pas d’état natif du cuir, juste un animal mort auquel on a arraché l’empreinte de son image. Son entreprise, indécise et périlleuse, était de redonner vie à un matériau menacé de corruption organique, chargé d’une trouble animalité. Le cuir était certes utilisé pour le confort avant même de songer à sa beauté, à sa valeur décorative. Raimbaud lui conférait de la noblesse, tout en le tenant à distance de l’artisanat, milieu qu’il connaissait et admirait. Un grand-père forgeron, un père ébéniste et une mère couturière, on ne pouvait trouver meilleur terreau à cet art singulier. Dans ses souvenirs, Raimbaud revenait dans la forge de l’aïeul : les harnais, la ferraille, les chevaux, les machines, le foutoir de la cour… Dans un article sur le nœud, il évoquait ce milieu artisanal : « Langue des professionnels, hommes simples, amarinés d’une expérience… »10. Retenant du monde maritime la modestie du faire et la répétition compulsive du geste élémentaire, il rappelait le ramendage, le raccommodage, le nouage, le marquage… On ne trouvera pourtant pas chez Raimbaud une stérile admiration du nœud de marin, car il en inventait. Par ailleurs, la mémoire de la main ne lui suffisant plus, il prenait goût au bricolage, celui-là même pratiqué assidûment du cubisme à dada. Le Père Gaston (1972), hommage à Chaissac, est un totem, assemblage de planches de bois, d’une chaussure, de lambeaux de cuir de chalut, de rivets … On ne saurait pousser plus loin la métaphore figurative. Plus tard, une petite sculpture ramassée sur elle-même, comme en bascule, associe des morceaux de bois peints, une boule et un anneau polis, des lanières de cuir. Elle côtoie sans difficulté un objet de type constructiviste ou un collage onirique de Joseph Cornell. Ainsi, passant des grandes dimensions aux petites, Raimbaud réalisait des exercices riches en précision et ingéniosité.
La rencontre de Gaston Chaissac fut pour Raimbaud d’une importance capitale. En 1953, ce dernier établi dans le bourg de Sainte-Florence était un auteur de la NRF, chroniqueur ayant écrit Hippobosque au bocage. N’étant pas reconnu par son entourage immédiat, il avait obtenu une notoriété, teintée d’une excentricité et d’une exigeante indépendance. Le jeune Raimbaud fut durablement impressionné par le « Morviandiau en blouse boquine ». Celui-ci, Cordonnier in partibus, artisan par raccroc, cultivait ostensiblement sa vocation d’artiste. Raimbaud, artiste in partibus, assurant avec son métier d’enseignant la subsistance familiale, était attentif, disponible. Chaissac lui apprit à être artiste, c’est-à-dire à en évaluer les droits et les devoirs. Plus encore, il lui dévoila les ressources de la récupération à la jaille, la noblesse du déchet. En 1999, Raimbaud disait son admiration de l’œuvre: « comme si le moindre brin d’herbe, le pauvre carton d’emballage, les pierres, les souches pourries, le verre cassé, la serpillière mouillée, les si banales épluchures, le cerisier qui pousse dans le vieux mur, tout devenait germe »11 . Il soutenait que du vieux, de l’abandonné, allait naître du neuf, comme lui-même l’avait essayé avec ses cuirs de cul de chalut. Dans la transfiguration du rebut, la confusion des sens et des images ne pouvait qu’être stimulante pour le créateur : « comme le parasite, tout ce qui est assis à côté, et perturbe le circuit, crée un cancer en une culture nouvelle»12. Jamais Raimbaud ne perdit de vue cet apprentissage libertaire, dispensé par un faux professeur : il en tirait une méthode qui ne disait pas son nom.
Accouplant l’oralité du patois et la préciosité de quelques mots piochés dans le dictionnaire, Chaissac mettait au jour une foisonnante écriture dans ses contes ou sa correspondance : « vous pouvez faire un rapprochement entre mes tableaux et la ruralité du langage des paysans… »13. Avec la valse des mots, il tirait à lui idiotismes et néologismes, mais tout restait affaire de culture. Raimbaud le comprenait bien qui, lesté d’une solide formation littéraire, inventait et raboutait les locutions éparses. Il y allait des mots comme des choses. Des titres évocateurs comme des prénoms, bien en bouche, honoraient les sculptures. Sans en énumérer les racines, rappelons-en la variété, tout en soulignant le travail d’écriture de l’artiste pour les accompagner. Son premier texte, dans le catalogue de 1974, donnait le ton avec des explications à l’emporte-pièce, d’une poésie ronde et sonore14. Au cœur de l’œuvre, Raimbaud dépouillait le langage de toute dialectique superflue. Il le puisait dans la lecture d’un Rabelais souvent invoqué : La Gargamoëlle… , Badigoules, La Sibylle de Panzoult, La Folie Gargantuine… Tout Rabelais retentit de la célébration outrancière du corps, des humeurs du ventre (Le mythe de Gaster). Jarry, en droite ligne, lui succédera bientôt. Raimbaud utilisait aussi la langue verte de la Chaume, celle des marins, qu’il habillait de sa perception subjective : godaille, drigail, écobaille, capeler, margate, Gaboria, marache…15. Ces mots redoublaient l’expression de sa dette envers l’Océan. De loin en loin apparaissaient les poètes, Villon, Rimbaud, Michaux et plus précisément Malcolm de Chazal qu’il admirait pour « la vie derrière les choses »16. À son propos, Paulhan notait que sa réalisation poétique était de faire image avec le corps17. Les aphorismes de Sens-plastique trouvaient un écho dans les cuirs de Raimbaud avec la morphologie à la fois disloquée et renaissante, avec une certaine logique des sensations. Au final il vivait son époque, convertissant langage et formes en un seul et même mouvement. Nous reviennent à l’esprit les textes vertigineux, les « écritures illisibles » d’un Bernard Réquichot vite disparu, nous léguant l’art comme un mythe extrême : « Rares sont ceux qui pensent et ceux qui sentent, rares sont ceux pour qui les mots n’ont pas encore de sens »18.
En récupérant des culs de chalut usés par les fonds marins pour en faire des sculptures, Raimbaud avait la conscience immédiate de l’ambiguïté d’un tel matériau, de sa forte teneur symbolique. Il lui fallait dépasser l’effet répulsif de la dépouille, de la bête dépecée. Nous sommes ici loin du Lion de Némée, de cet Hercule vainqueur ne sachant écorcher le fauve qu’il avait vaincu et qui, par sa peau, lui assurait l’invulnérabilité. Les peaux de vache ou de taureau, en tannerie, sont rigoureusement sélectionnées après la tuerie en abattoirs19. Peut-on parler de l’hécatombe, de l’effrayant sacrifice à venir que Raimbaud avait dévoilé dans un texte donné en 1982 à la galerie Galarté : « pauvre sac de tripes pendu au plus haut pour aucun appui, la quatrième [patte] révulsée pour le ferrage du métal chaud sur de la corne fumante »20. Après 1974, l’artiste travaillait essentiellement avec du cuir brassé en foulon, tanné au chrome, afin de devenir bleu et imputrescible. Un cuir épais, complet, pouvait peser 50 kilos, s’étaler sur 7m2… C’est dire l’exercice physique que représentaient sa manipulation et son transport. Raimbaud choisissait des peaux fautées, c’est-à-dire griffées, conservant à la culée, au collet, les traces d’une vie évanouie. Une cartographie étrange trouvait son expression, comme dans les photographies de paumes ou de mains de John Coplans. Une peau entière drapait une sculpture comme, par exemple, le Mur du père (1974). Chaque peau racontant une histoire, Raimbaud veillait à la garder dans son intégrité pour la disposer, aile ou voile, dans une Folle Gabare.
Les tanneurs d’autrefois évoluaient dans les miasmes des bas quartiers et se faisaient discrets pour dissiper la négociation avec la mort. Raimbaud, avec le cuir, résidu sec, produit d’une transformation, disait l’avoir évacué : « ma vision du monde, c’est que les Peaux de Vache n’existant pas dans la nature, leur invention ramène à elles l’humanité, les végétaux, les minéraux, les météores »21. La bête, sa souffrance, étant refoulées, le cuir qui dure devenait un matériau ductile pour le sculpteur.
Revenons en arrière et envisageons le cuir dans sa durée. Les archéologues exhument encore des boucliers, des ceinturons, des sandales… Plus fascinantes sont les momies de guerrier, telle celle de cet homme des glaces de 5000 ans soigneusement conservé dans un musée frigorifique à Bolzano. La peau humaine, brillante comme un vieux cuir de valise, lui confère une confortable et familière immortalité. De l’ethnographie à l’actionnisme, jamais elle ne nous lâche.
Jouant de la matière et du toucher, Raimbaud a évolué, du cul de chalut éreinté et sombre, à la peau de vache nuagiste, virée au bleu. Avec Belphégor (1972) ou Le Reître écorché (1971), l’attraction sexuelle du cuir était sans équivoque : celui‑ci lacé et serré, épousait au plus près l’âme de bois d’un corps totémique, des calottes de bourreau complétant le tout. On hésitait entre un priape ou un fantôme. Matière fétiche, à la fois « sauvage » et « civilisé », le cuir reste surdéterminé par la sexualité. Finalement Raimbaud trouvait ses deux œuvres inquiétantes et trop chargées de pathos. Au même moment, le cuir de chalut habillait ou dénudait bois et racines, brûlés ou polis. Dans Béluga (1971) ou Maternité (1974), ces deux matériaux se confondaient en une concrétion organique, une anomalie surgi de la nuit des temps.
Avec les peaux neuves, Raimbaud ouvrait des virtualités supplémentaires, aux effets plus apaisés : charger celles‑ci de galets et les faire sécher pour leur donner des formes durables (les Grands Dos, les Grandes Culottes) ; les retrousser pour jouer à la fois de la fleur et de l’épiderme, du pelucheux et du lisse (les Noueries) ; utiliser la couleur pour ce qu’elle est, conjonction suprême du ciel et de la mer (les Gabares). Deux constatations majeures s’imposent. En premier lieu, les œuvres s’accommodaient de l’espace en entier : pendues au plafond, plaquées au mur, sur le dos ou sur le ventre, associées ou isolées … En second lieu, avec cette « chiffonnade » de peau, le corps triomphait pour l’évocation de son intérieur, tripes et entrailles, pour celle, insistante, de la féminité et de la fécondité, vulve et utérus : la Galle d’Aiguail (1978), relief généreux, constituée d’organes ouverts et fermés, illustre s’il en est besoin la violence de cette énergie vitale.
Associer l’œuvre de Raimbaud à la seule utilisation du matériau cuir relève d’un mauvais jugement. A l’exception, peut-être, de Kalinowski construisant des stèles et des caissons couverts de cuir (cassone à secrets), il n’y a pas d’artistes aussi nettement engagés dans ce choix. Ses bibelots raffinés, petits meubles, compliqués d’un baroquisme sexuel et sacral, sont à mille lieues des élévations débridées de Raimbaud. Ce dernier ne bordait pas le cuir comme pour une reliure, mais l’étendait et l’écartelait pour l’offrir. Ses premières sculptures restaient proches de modèles classiques. L’Oiseau mort (1971), avec son drapé anguleux, son demi-relief, rappelait un ange du gothique international. Le drapé revint régulièrement dans les œuvres en particulier pour les Mages de 1986 (Gaspar, Balthazar, Melchior). Tout aussi évidents, dans les reliefs muraux, pointaient des rappels matiéristes visibles dans les œuvres d’artistes tels que Tapies, Millares ou Burri : dans la traversée des plans, dans l’utilisation des lambeaux, guenilles et sacs, pour les uns, cuir écharpé pour Raimbaud.
Étienne-Martin semblerait être l’artiste le plus proche de Raimbaud. De formation indépendante, passé par l’Académie Ranson de Bissière, il s’était arraché à l’abstraction en réalisant des sculptures dans d’énormes masses de bois, troncs, souches, racines. La dimension physique d’un tel travail n’avait pas échappé à Raimbaud. Avec la série des Demeures échappant aux catégories de la sculpture et de l’architecture, Étienne‑Martin lui offrait encore matière à réflexion : considérant que l’anecdote tenait de l’énigme, il avait fait de sa vie une mythologie et concevait chaque Demeure, construction en plâtre armé, comme telle ou telle pièce de sa maison natale de Loriol. Nostalgie active. Outre une attirance partagée pour le tarot et l’alchimie, l’actualisation du symbolisme et du rêve rapprochait les deux créateurs : « je me suis souvenu de mon enfance et j’ai dessiné ma maison. Une maison. Cette maison c’est moi. Moi avec mes contradictions et les pièces sont le cheminement de ma pensée, de ma vie avec toutes les époques »22 affirmait Étienne‑Martin. Raimbaud suivait cette figure tutélaire avec sa série des Gabares renvoyant à l’habitat, avec son autobiographie, construite, bousculée, démontée et réapparaissant d’une installation à une autre.
On ne saurait enfin éluder les rapports entre le travail de Raimbaud et le mouvement Supports-Surfaces. Influents au milieu des années 70, les membres de ce groupe encourageaient la mise à nu de l’art prônant en particulier les gestes artisanaux, le recours aux techniques naturelles. Nous songeons à Christian Jaccard qui élabora un vocabulaire d’outils et de nœuds (les Libidinœuds et les Nouures, par exemple)23. Si Raimbaud participa pleinement à l’évasion des musées, à l’expérience de l’œuvre en plein air, il se montrait méfiant envers les dogmes. Des gestes, il ne retenait pas les procédures, mais la liberté qu’ils lui garantissaient, en plus, pour une création in situ.
Raimbaud vouait un véritable culte à ]’Océan : mythologie fusionnelle et terrain d’opérations. Miroir du monde, ses humeurs pendulaires ramenaient aux réalités des sculptures, en réduction. On ne saura jamais si les attitudes du Land-Art correspondaient avec exactitude à ses recherches : il voyait le paysage maritime comme un écrin et non comme une fin en soi. L’artiste prenait à la Nature ce qu’elle lui abandonnait : un os vaut bien une pierre, vaut bien une seiche, vaut bien un morceau de bois… L’âme dure de ce bois, sa forme immémoriale méritaient un sauvetage. Dubuffet dans le Foyer de l’Art Brut de Drouin avait bien exposé les cailloux anthropomorphes de Juva. Avec les bois flottés, comme avec les cuirs, Raimbaud relativisait l’inertie de la mort. Il la mettait en veille.
La Gargamoëlle aux oyseaux avait anticipé les Folles Gabares du nom de cette embarcation grossière, bateau de rien des fleuves de France. Elles s’élevaient comme des navires avec leurs voiles de cuir tendu entre des mâts de fortune, mais on y voyait aussi des maisons et des machines à voler. Comment concilier la prise au vent et le nécessaire ancrage au sol ? Les Gabares naissaient de la « Pêche à la Côte », ramassage des bois flottés, entre amis, sur les plages des Olonnes24. Sélectionnés pour leur section, leur courbure, la qualité de leur fourche, ils étaient assemblés selon un principe directeur : un chevalet, une triangulation, se démultipliant pour assurer élévation et équilibre. Raimbaud arrimait « à la coince » des peaux entières, rarement les flancs plus ordinaires. Les Folles Gabares sont sans doute à mettre en rapport avec les architectures utopiques, celles des Américains dans les années 60 : comment ne pas penser aux rêves d’artistes, aux maisons d’Hundertwasser ? Raimbaud se voyait urbaniste et cette forêt de maquettes de gabares, village de tentes et habitat suspendu, lui rend justice.
Au fond du jardin de La Pironnière, la Folle Gabare aux charrettes marque la volonté de Raimbaud d’évoluer dans un univers naturel, en perpétuelle évolution. Il travailla jusqu’à ses dernières forces dans ce lieu d’échanges et d’expériences: laboratoire, cabane, chambre, cuisine, nid de marsupilamis… Le vent, la pluie et les tempêtes lui imposaient une partie de bras de fer, un « pousse au travail » selon son expression. Il fallait revenir dans l’œuvre pour la réparer, l’améliorer encore. Maîtresse exigeante, la Gabare ne l’épargnait pas : il le lui rendait bien.
Benoît Decron
Texte : Droits réservés.
Notes
1.Avant-projet de Décoration au titre des 1% de l’école maternelle de Saint‑Florent-des-Bois, 30 novembre 1989. Michel Raimbaud et le cabinet Durand-Mesnard. Archives communales de Saint-Florent.
2. La Nef des Fols, spectacle chorégraphique de la Compagnie Catherine Massiot, 26 juillet 1998 au château de Pierre-Levée (Olonne-sur-Mer).
3. Benoît Decron, Hommage à Michel Raimbaud, dans 303 Arts. Recherches et Créations, n° 74, 2002, pp. 50-55; p. 51.
4. Dans l’ordre de leur apparition, les principaux photographes de l’œuvre de Raimbaud sont Yves Lemasson, Gérald Lécheneau, Marinette Delanné, Jacques Boulissière, Leslie Laidet, Franck Guareau et Pascal Stritt. L’artiste réalisa lui-même bon nombre de clichés.
5. Dominique Baqué, La photographie plasticienne: un art paradoxal, Paris, Éditions du Regard, 1998, p. 20.
6. Pour détailler la chronologie de l’œuvre de l’artiste, se reporter au travail remarquable de Violaine Raimbaud, pp. 23-27.
7. Naufrage du Pléni, 1965, huile sur toile, 73 x 118 cm, coll. part.
8. Ill. n° 12 du catalogue Peaux de vache et Folle Gabare 7, Musée des Beaux‑Arts de Nantes, 18 mai-3 septembre 1979. Publication riche en photographies documentaires, avec une bibliographie complète.
9. Ibid., texte Michel Raimbaud.
10. Michel Raimbaud,« Le nœud dans l’art contemporain», dans Le Bulletin de la Société des Amis du Musée, n° 11, 1999, p. 5.
11. Michel Raimbaud,« Chaissac « Grand choix d’idées contradictoires » »,dans Triages, n° 10-11, avril 1999, p. 6.
12. Ibid., p. 7. En 1997, lors d’une exposition au musée, Michel Raimbaud revit les tentures de Roger Bissière, rafistolages de tapis, de vieilles chaussettes et de bout de flanelles et en conçut une grande admiration.
13. Relevé Serge Fauchereau, Gaston Chaissac – environs et apartés, Paris, Somogy, 2000, p. 109. La seule étude importante sur l’écriture de Chaissac.
14. Michel Raimbaud, « Des gestes d’artisans pour un message de poète », dans catalogue, Les Sables d’Olonne, 1979, pp. 10-13.
15. Roland Mornet, Le parler Roselys ou le Glossaire maritimo-chaumois, 70 pages dactylographiées, s.d., Bibliothèque du musée.
16. Lettre de Michel Raimbaud à Geneviève Bonnefoi, 12 juillet 1985.
17. Malcolm de Chazal, Sens-plastique, 1998. Préface de Jean Paulhan « Malcolm de Chazal, l’homme des passages ».
18. Les Écrits de Bernard Réquichot, Bruxelles, La Connaissance, 1973. Préface d’Alain Jouffroy, dans « Journal sans dates», p. 123.
19. Indications fournies en octobre 2002 par Daniel Augereau, directeur des Tanneries de la Vallée à Tiffauges.
20. Catalogue de la galerie Galarté, 1er mai 1982.
21. Entretien Michel Raimbaud/ Laurence lmbernon, dans Folles Vacheries et Belles Gabares, Musée de La Roche‑sur‑Yon, 1995, p. 7.
22. Étienne-Martin, Les Demeures, Mnam, 1984, p. 38.
23. Christian Jaccard, Art/ Cahier 3, S.M.I., 1976; lettre de JaccarD à Germain Viane, p. 6.
24. Entretien Gérald Lécheneau / Benoît Decron, enregistrement du 10 octobre 2002.
Une journée entière dans un arbre - Harry Bellet
J’ai eu une pensée pour Michel Raimbaud au mois d’août dernier. Perché dans un arbre, je construisais une cabane pour mes enfants. Un truc très simple, une plate-forme de planches avec une balustrade. Ce n’était pas, loin de là, ma première expérience en la matière. Quand j’étais gosse, nous rejouions avec des camarades notre version de La Guerre des boutons. Deux bandes rivales s’affrontaient dans la petite vallée de Normandie où j’ai grandi. Il s’agissait de trouver le campement de nos adversaires, et de le démolir. Cela n’allait pas sans quelques horions et genoux couronnés, et nous construisions nos fortifications dans les branches les plus hautes, pour mieux bombarder de pommes pourries les envahisseurs.
Quelques décennies plus tard, en 1995, j’usais ce qui me restait de belle jeunesse au Centre Pompidou. J’y rencontrais la fille de Michel, Violaine, qui me parla du travail de son père. Durant l’été, je trimbalais ma petite famille sur les routes de France, d’un musée à un autre. Michel exposait à La Roche-sur- Yon. Comme je ne connaissais son travail que sous forme de photographies, l’occasion était bonne. J’ai donc fait une halte chez lui, aux Sables d’Olonne.
J’ai devant les yeux quelques instantanés pris à cette époque : l’un a été fait au musée de La Roche-sur-Yon. Mon fils aîné est juché sur des branches de bois flotté, qui forment la structure d’une sculpture couverte de peaux de vaches. Son cadet, alors âgé de quinze mois, se tient debout sur une partie plane du cuir, soutenu par sa mère.
Mes enfants n’aiment guère les musées. Ce sont des endroits où leur père travaille, où l’on ne peut pas jouer, et où il est interdit de toucher aux Van Gogh. Là, pourtant, tout était différent: les gardiens souriaient en regardant les gamins piétiner les œuvres, grimper dessus et y faire du toboggan. Une autre photographie me représente en train de me prendre pour Tarzan. Un peu plus vêtu, et moins musclé, tout de même. Elle a été prise chez Michel. Il habitait une petite maison, avec un atelier attenant où il rangeait ses sculptures, et stockait les peaux de bêtes qui en étaient la base. Dans le jardin, il y avait un grand arbre, un chêne. Je me souviens que le pied en était flanqué d’une formidable charrette antique d’un bleu passé, avec des roues à rayons de bois, cerclées de fer. Par-dessus, au fil des années, il avait construit une cabane de plusieurs étages où s’enchevêtraient des filets de pêche, des haussières ramassées sur la grève, des cuirs de culs de chalut fatigués d’avoir raclé le fond des mers, et qui prenaient leur retraite dans les branches, loin des maquereaux, et aimés des oiseaux.
Je ne sais qui de l’assistance a pris la photo, mais elle me montre en train de faire l’andouille au plus haut de la construction, en équilibre sur un cordage qui la reliait au balcon de l’atelier. Je n’ai rien d’un funambule : un second cordage, plus haut, parallèle au premier, offrait une prise pour les mains. Mais tout de même, on exige rarement d’un historien d’art ni d’un critique qu’il grimpe aux œuvres. Sauf les médiévistes, peut-être, qui se doivent de crapahuter dans les galeries hautes des cathédrales. Ou les préhistoriens, heureux de s’enfoncer dans les grottes. Ma spécialité étant plus contemporaine, les lieux les plus exotiques que je suis amené à fréquenter sont les ateliers. J’essaie d’y garder un semblant d’objectivité, de tempérer toute trace d’enthousiasme ou de déception. De regarder l’œuvre le plus froidement qu’il m’est possible. Là, c’est franchement raté: le photographe anonyme m’a surpris avec une expression du visage rarement de mise dans mon métier. J’ai l’air niais. Ou simplement hilare, ce qui revient au même. Ce diable de Michel parvenait à provoquer cela, naturellement.
Il avait nommé cette sculpture « Folle Gabare ».
Dans le vocabulaire maritime, ou fluvial, le mot gabare désigne un navire de charge ou de transport. Elles sont souvent méprisées, pour être à l’origine des dragueuses de vase, les maries-salopes. Pourtant, c’est dans une gabare que Dumont d’Urville fait son premier tour du monde, puis part sur les traces de La Pérouse et découvre la Terre Adélie. Le statut des Folles Gabares de Michel revêt la même ambiguïté. Violaine Raimbaud se souvient que « l’ancêtre de la Folle Gabare du jardin est une structure habitable, La Gargamoëlle aux oyseaux, réalisée avec des cuirs de culs de chalut ». Exécutée en 1973, elle reçoit le prix André Susse au salon de la Jeune Sculpture cette année-là. En 1980, il récidive avec cette sorte de Merzbau, d’architecture sans fin, qu’était la Folle Gabare du jardin, dans et sur laquelle je me suis perdu quinze ans plus tard. C’était une vraie maison, avec ses pièces, plus ou moins clairement délimitées. Dans sa version d’origine, sa fille indique clairement l’emplacement de la cuisine, du salon, de la chambre qui mène au donjon. Dans un agenda de l’année 1987, Michel précise le choix de ce titre générique : « Les gabares sont des métaphores de la goule… » Rien à voir avec le vampire femelle nécrophage. Le terme, même s’il ne figure pas ainsi au dictionnaire, désigne d’après Michel la « grêle au vent du grand large… » Suivent ces deux mot « Espace = imaginaire ».
A étudier l’œuvre de Raimbaud, on pourrait aisément l’intégrer aux mouvements les plus avant-gardistes de sa génération, et notamment le groupe Support/Surface. On peut aussi, à cause de son amitié avec Gaston Chaissac, qu’il avait rencontré en 1953, en faire un tenant de l’art brut. L’une e l’autre direction seraient, à mon sens, insuffisantes. De Chaissac, il avait l’extrême indépendance d’esprit. Comme lui, il est tout sauf un naïf. Sérieusement instruit (il a gagné sa vie comme professeur de dessin, comme instituteur puis comme professeur de collège), il est aussi intégré au monde de l’art contemporain, comme en témoignent plusieurs expositions dans différents salons, dans des galeries et des musées (voir biographie). Ses carnets révèlent également une passion pour l’architecture (il annote ainsi précisément un livre sur les proportions du temple de Louxor, et leur rapport au corps humain). Rien n’est moins hasardeux que ses constructions. Il accumule une impressionnante documentation sur les charrettes anciennes, dont il aime, outre la solidité et les qualités d’assemblage, des aspects symboliques, comme « la poésie du voyage et du passage de vie à trépas ». Il analyse également les procédés de construction en bois, des villages Papous aux chantiers navals des Sables, en passant par différentes formes de ponts et de toitures. Il profite aussi de ses séjours à Paris pour regarder les travaux de ses contemporains : ses carnets recèlent une étude fouillée des effets produits par l’installation dans un jardin public parisien de Clara-Clara, une sculpture monumentale de l’américain Richard Serra, mais aussi des œuvres de Donald Judd et de Carl Andre. Des minimalistes dont on le sent proche, sans doute à cause de l’importance qu’ils accordent à l’impact de leur œuvre dans le paysage et sur le spectateur : « Toute sculpture est d’abord celle du corps… », note t-il dans un de ses agendas.
Mais un de ses manuscrits donne une clé de son parcours singulier : il propose une « animation plutôt qu’une exposition » pour « provoquer chez les gens (ou les enfants) un déclic – un dérangement inhabituel du petit moteur de leur pensée pour que ce silence les emmène ailleurs… » Pour cela, il choisit de préférence des espaces publics, comme en 1978 la plage des Sables d’Olonne. Un autre texte, encadré de dessins esquissant le projet de décoration pour le lycée de Challans (Vendée), précise cette volonté: « La Folle Gabare fonctionne comme cabane, forêt et navire. On y grimpe comme aux arbres, on s’y balance comme sur une barque, on domine comme d’une hune, on se blottit dans les hamacs, on s’abrite sous les auvents de cuir… »
Michel Raimbaud avait su retrouver à mon avis quelques éléments essentiels aux hommes. Il les a résumés dans des notes que je retranscris telles quelles :
« L’acte de construire des huttes est certainement l’un des plus naturels à l’espèce humaine (avec celui de dessiner… grottes) et celui de grimper plus antérieur encore -> la forêt.
– Et quant au jeune enfant aussitôt qu’il peut grimper quelque part, il extériorise son désir de grandir sur tous les objets à sa portée.
– Et quand j’ai construit (vers 69) un bouquet de bois blanc … devenu Folle Gabare au Salon de Mai 74, ma fille en a fait sa cabane, le royaume de ses rêves d’enfant».
Et quand moi, je suis monté dedans, un jour de l’été 1995, j’ai senti que je rencontrais un artiste et un homme inoubliable. Merci Michel.
Harry Bellet
Texte : Droits réservés.
Mémoire d'atelier - Gérald Lécheneau
 « Comme si
« Comme si
On avait fait un nœud à son tourment
Un nœud à sa douleur. Comme si
Un nœud à son désir… »
Vous parler d’un chaos dans la lumière accrochée aux brins des palans, la poussière énervée dans les raies du levant. Déjà, les peaux durcies grincent et s’imaginent des mâtures torturées. La peau travaille sans trêve, étreinte minérale portée au bleu, ligatures comme les repentirs d’un travail antécédent, bordant les plis à venir dans le limon de la nuit. Peaux trop courtes pour trop d’os avec la tripe au vent de nos rêves dans le naufrage du jour.
Qui donc parlera de la poussière et du rebut, de la pourriture et de l’abandon ? Car enfin, de ce ventre, les naissances ici aussi se faisaient entre « trou qui pisse et trou qui chie ». Matrice de galets et forceps aux poulies, le vagin bordé d’attirail pondait de volée ses œuvres utérines, qu’au soir, épuisés mais heureux, nous accrochions aux cimaises. De portées en tribus, tout un « drigaille » d’atelier jonchait le sol où s’enflaient les fermentations des mises bas futures. Lui, démiurge-accoucheur, nos mains aux lèvres du creuset fouillaient, tiraient, ripaient, l’un passant les pinces l’autre écartant la tripe, petit à petit la transmutation prenait corps et je voyais dans son œil au raz de ma goule briller sa malice philosophale. Ai-je jamais compris le miracle ?
Avec trois bouts faire un monde !
Dessiner un alphabet, inventer un vocabulaire, composer une syntaxe et accoucher d’une saga arachnéenne pour une tribu hiératique embarquant sur une armada de gabares et de charrettes ! Pirate et Pélagie de par ici, trafiquant d’angoisses nées aux abysses, mise en abîme de peurs nouées aux origines de l’enfance, écriture de plein vent déclamée à fleur de peau.
De l’enfance, déjà le chaos, le giron à jamais perdu, acier du père au bleu du regard, cabane sous la table des dimanches – un ventre – tramail de l’oncle où le cuir gueulait au soufflet de la forge.
– Guernica aussi à l’aube d’une boucherie –
De l’homme qui tutoie l’océan, ce miroir qui double la mise et berce les étoiles, chalute des palanquées de rêves à connaître avec en écho, la voix tonitruante battant le rappel des copains, compagnons de bordées mémorables, commandos de naufrageurs ancrés aux troncs échoués, horde braillarde au cul de la barrique et pour toujours, l’amitié, cette connivence au long cours, ce butin tranché à parts égales !
Du maître à bord avant tous qui, composant des équipages improbables – ici un éclopé ou deux, là des souliers vernis – balançait des embruns de poussière et de copeaux, rayait les parquets, virait les tapis et riait de voir faire aux bourgeois des rêves de chaussures à la vue d’une peau de vache ! La Folle Gabare, maintenant, pousse les murs et démonte les portes : tempête sous les lambris et sortant de l’école des moussaillons de récré prennent leur rôle bien avant la mise à l’eau, embarquement prématuré, pêche miraculeuse de plaisir avant des temps plus graves.
Et puis bien sûr, de retour en solstices, de portes ouvertes en Saint Michel, grand ménage de la cale au pont ! La poussière et le bourrier dans les coins, la fête au milieu ! L’atelier en taverne à Rabelais et à Bruant ! L’écot des uns et la gouaille des autres pour une ripaille d’enfer et trois temps pour charmer les Belles !
T’en as vu passer du bonheur !
« … En tout cas un nœud
Pour toucher à du vivant. Même si
Avec de la mort dedans ».
James Sacré
À l’Ami « saute-ruisseau de l’art » - Geneviève Bonnefoi
À l’Ami « saute-ruisseau de l’art »*
Avril ou mai 82-découverte d’une œuvre impressionnante, grande peau gris bleuté aux formes mi-humaines, mi‑animales, suspendue dans la vitrine de la petite galerie Galarté, rue Mazarine. Curiosité piquée, je rentre et vois quelques pièces plus petites mais fortes dans lesquelles fer, bois et cuir s’entrelacent violemment. Je m’enquiers de l’artiste qui vit, hélas, loin de Paris ou de Beaulieu, aux Sables d’Olonne … Vendée !
Je n’oublierai pourtant pas et commença entre nous une longue correspondance dans laquelle il se racontait avec la verve, l’humour, la poésie qui le caractérisent. Les deux « cahiers bleus » superbes avec toutes leurs photos et commentaires m’enchantèrent. Puis ce fut le premier voyage au Château d’Olonne, tout près des Sables, la découverte de la maison-atelier-jardin, où s’accumulaient de nombreuses sculptures, des plus petites aux plus géantes, autre choc inoubliable.
Ainsi donc une œuvre considérable était là, d’une force et d’une invention peu communes (je dirais presque comparable à celle d’un César dans un tout autre registre) et pratiquement ignorée, tout au moins des grands responsables culturels. N’avait-il pas le malheur de vivre loin de Paris – comme tant d’autres que nous connaissons – auprès de cette mer magnifique dont il tirait à la fois son inspiration et le plus souvent la matière de ses œuvres : vieux « culs de chaluts » usés par les fonds rugueux, bois blanchis de sel, cailloux destinés à ouvrir des gueules béantes dans les « peaux de vaches » qu’il utilisera plus tard pour en faire d’étonnantes sculptures trouées de vent, où les pleins et les vides crient et chantent avec lui, hurlent parfois des chants désespérés, telle la fabuleuse Escarbote de printemps reproduite dans La Lettre de Beaulieu n° 2 (sept. 98) que j’aurais tant aimé voir entrer dans la Collection de l’Abbaye, toujours hélas, privée de crédits.
Ses Folles Gabares, monuments de peau et de bois divers, confrontées à l’Océan, dans lesquelles il aimait à voir grimper les enfants, se sont élevées fièrement et joyeusement vers le ciel jusqu’à plusieurs mètres de haut sans que Paris s’en émeuve, alors que des musées comme l’Abbaye Sainte-Croix – toute proche il est vrai -, ceux de Libourne, de La Roche-sur-Yon, de Pau, etc et jusqu’aux Allemands, lui ont consacré d’importantes expositions.
Lorsqu’en 1985 je découvris les prémisses de la formidable installation du beffroi de Millau, je n’eus qu’un désir : en écrire et en parler avec toute l’admiration que cela m’inspirait et Michel Raimbaud, lui-même, me le demanda quasi solennellement. La vue de ces grandes formes aux tons livides, suspendues en envolée dans la superbe tour de pierre et reflétées dans un miroir posé au sol avait quelque chose d’hallucinant. « Suspendues sur des haussières de marine, écrivais-je alors, elles semblent monter à l’assaut de l’espace en une cohorte baroque, menant là une étrange vie aérienne et poétique qui les a arrachées à la mer ». C’est à nos amis Claude et Elisabeth Baillon, eux-même artistes de qualité, que revint le mérite d’avoir suscité et organisé cette exposition que François Mitterrand en personne vint découvrir un jour.
A partir de cette date mon amitié avec Michel Raimbaud devint plus étroite : il m’envoyait de gros cahiers sur papier teinté de bleu dans lesquels il mêlait textes et photos, me parlant de son travail, évoquant parfois des souvenirs d’enfance comme « ces charrettes cahotantes dans les chemins creux du bocage », me contant comment « à travers les matériaux bruts, il cherchait l’alliance des mondes : le minéral, l’animal, le végétal ». Il vint à Beaulieu deux ou trois fois voir nos expositions malgré la distance et une santé qui se dégradait d’année en année et j’allais moi-même le voir trop rarement à mon gré. C’était à chaque fois une même joie de retrouvailles et des parlottes interminables et passionnantes. Michel, comme le disait Jean-Jacques Saignes, « lui c’était un vrai artiste ». Pas de concessions, pas de flagorneries, il allait tout droit son chemin, avec les hauts et les bas de ce dur métier, me confiant parfois ses désillusions mais repartant avec courage et puisant sa force dans cette mer qu’il disait souvent « belle et bonne ».
Écrivant à propos de cette « œuvre immense » de Chaissac qu’il admirait tant, qu’elle « ira rajeunissant comme toute œuvre essentielle », on ne peut que lui souhaiter le même sort et que son œuvre à lui, Michel Raimbaud, enfin reconnue au-delà du cercle presque intime de la Côte Ouest (nous avons la nôtre aussi) aille en grandissant et en rajeunissant… même si elle est déjà à nos yeux d’une jeunesse éclatante.
Geneviève Bonnefoi
Abbaye de Beaulieu,
12 novembre 2002
* C’est ainsi qu’il se désignait lui-même dans un des « cahiers bleus ».
Texte : Droits réservés.
Petite ode à Michel Raimbaud - André Audureau
longtemps j’ai aimé ses bois
membres révulsés témoins de quelles tourmentes
épaves usées par d’interminables flottaisons
aux clapotis radoteurs
j’aimais ses cuirs
j’a1ma1s ses peaux
enveloppes encore douces des primitifs accouplements
j’aimais le fer planté entre bois et peau
pièces à conviction de la lutte éternelle
des matériaux
j’aimais tout cela d’instinct
on en sent la force virile
les parfums lourds des muscs animaux
terreaux des terroirs aux senteurs forestières
tensions et torsions des désirs qui s’entrenouent
quand s’épousent secrètement la pierre et le feu
j’aimais ces sculptures parce que j’aimais cet homme
rugueux et tendre comme un arbre familier
qui parle de la mer des marins des étoiles
de noeuds qui s’entrelacent et des mouvantes voiles
en caressant son chat ensoleillé du matin
qui parle du désert du silence
en écrasant au coeur de ses mains
la glaise vendéenne
qui se souvient de Chaissac comme d’un parent
trop fragile
qu’il a perdu trop tôt
longtemps j’ai aimé l’homme
j’ai aimé l’oeuvre
sans trop comprendre sans trop mesurer
comme ces gens qui vont en barque sur la mer
le dimanche en famille
et voguent sur les gouffres
sans même les soupçonner
je n’avais pas évalué l’orgueil de son ambition
la folie la démesure de son projet
enserrer contenir juguler ordonner maîtriser
imposer une forme aux désordres des vents
organiser les tempêtes
orchestrer les bourrasques
les piéger dans les nasses des panses bovines
les rendre musiciennes dans les bois assemblés
emprisonner les souffles affolés dans les mâtures
aux toiles torsadées
marier la charrue à l’esquif
le chalut à la charrue
et de ces épousailles tourmentées
accoucher les gabares
contraindre les torses musculeux des troncs
à endurer le cuir qui étreint et enserre
dans une insupportable torture d’amour
de quels enlacements inavouables
témoignent ces peaux bleuies
ces pierres ces membres ligneux
tortures médiévales ou copulation contre nature
longtemps j’ai aimé sans trop savoir
sans comprendre ce que je commence à deviner
peut être: cette oeuvre est SAUVAGE
et vient du plus profond de l’être
là où les forces obscures communient
dans de telluriques frissons
avec les mystères de l’éternelle CREATION
le 29 septembre 1993
jour de la saint Michel.
André Audureau
Texte : Droits réservés.
RAIMBAUD sculptures
Exposition Caisse d’Épargne de Vendée – Les Sables d’Olonne
1991
Textes : Droits réservés.
« Ce qui signale l’œuvre de Raimbaud dans le contexte de la sculpture actuelle, c’est son appartenance absolue à la Poésie. Chaque ligne, chaque mouvement, chaque volume indiqué ou surgissant est une des phrases d’un poème dont la gravité rejoint l’épopée et dont la surprenante légèreté des masses, des nœuds, des éclats a ses sources dans une fabuleuse satire. »
Quelque chose de noué - James Sacré
C’est abandonné sur la plage. Quelque chose de noué.
Mourir en a perdu son air tranquille.
Un paquet de peau mal foutu
Comme si quelqu’un s’était débattu dedans,
Toute une énergie
Qui a cherché des yeux pour s’en aller, qui a son cul fermé.
A la fin ça s’est raidi
Au maximum d’un effort. C’est peut-être plus rien, ou si
Ça continue d’accuser le sort ?
L’océan comme une vieille sorcière défaite.
C’est plein d’énergie et d’épuisements.
Comme si on avait noué une matrice
Un sac de plastique plein
Pour que ça reste dedans
(La sanie le sang qui saliraient) une matrice
Ou tout un corps mutilé, que ça s’échappe pas
Les organes pas retenus ; le nœud tire
On sent qu’il est bien fait.
On n’est pas trop fier d’en être content.
Comme si
On avait fait un nœud à son tourment
Un nœud à sa douleur. Comme si
Un nœud à son désir.
On sait mal pourquoi: une précaution, ou à cause d’une colère
C’est tout tendu
Comme un sac avec un gamin dedans
(les plus grands qui l’ont fourré là, l’enfant
Avait comme un désir d’y rentrer)
Le jeu. La peur. Les autres sont partis.
Le noir silencieux. L’océan comme une rumeur dans un grenier fermé.
Le temps fermé. La vie qu’on s’est débattu dedans.
On entend l’océan qui s’en va. On a
Un petit garçon noué, comme une crampe
Dans les mots qui sont venus.
A y regarder de plus près, le noeud rassure.
Parce que_la seule chose un peu solide.
Evidemment
On peut penser à un baillon autant
Qu’à un pansement. En tout cas un noeud
Pour toucher à du vivant. Même si
Avec de la mort dedans.
James SACRÉ
Texte : Droits réservés.
Fragments - Jean-Christian Fradin
FRAGMENTS
L’œuvre de Raimbaud traverse l’ère des confusions sans broncher, comme un météore. Mais, installé, incrusté dans un paysage, le météore s’y fond, s’y dissimule avec volupté, jusqu’à ce qu’un regard l’en déloge, un regard de mutant ou d’initié, pour le débarrasser de sa gangue de poussière et de folklore, pour enfin rejoindre la légende.
J’ai toujours pensé que les Folles Gabares de Raimbaud avaient autant à voir avec le monde des airs qu’avec celui des eaux, entre ciel et mer.
Mais très loin dans le ciel, dans des contrées immenses et innombrables, et très proches dans les eaux fœtales.
L’infiniment petit et l’infiniment grand brutalement confondus. Un sac de peau tendu jusqu’à la déchirure, jusqu’à ce qu’il atteigne une légèreté intemporelle.
Plus haut, en écrivant :« mutant » et « initié », je voulais exprimer par là comment « le découvreur », qui aborde aux Vacheries de Raimbaud doit être vierge de toutes scories culturelles liées aux modes de l’art officiel, mais en même temps au fait des puissances cosmiques est de tous les nœuds de symboles qui s’y rattachent et les dévoilent.
J’ai vu les cuirs de Raimbaud assaillis par les eaux de l’Océan, pénétrés, envahis, remplis se prêtant à cette jouissance dévastatrice.
Je les ai vus aussi resplendissants quand la mer s’est retirée, et que, ruisselants, ils semblent sortir du liquide amniotique.
Je les ai vus protecteurs, quand des enfants venaient s’y blottir ; ils semblaient alors échapper aux forces telluriques.
Je les ai vus comme une part de moi-même, la partie la plus obscure, la plus indicible, celle qui gît au fond de nos ténèbres, dans nos gouffres impalpables où remue le barbare aveugle, le primitif luxurieux, celui qui dort dans un lac souterrain, dans une grotte oubliée et qui s’éveille parfois pour tracer l’ineffable sur les parois de Lascaux ou d’Altamira.
Quand Raimbaud travaille dans son « Antre » (son atelier), il y a un rituel qui s’accomplit où le rire n’est pas absent.
L’humour est chez lui une des dimensions du sacré.
Rien de convenu chez Raimbaud, mais une force contenue faite pour les vivants.
Jean-Christian FRADIN
Texte : Droits réservés.
Vieilles Vacheries et Folles Gabares
Exposition au Musée des Beaux-Arts de Pau
Août – Octobre 1998
Textes : Droits réservés.
Raimbaud l'Olonnois - Philippe Comte
Ainsi sur sa lignée s’explique l’olonnois Michel Raimbaud, hors de la banalité convenue des curriculum vitae. Au bord des grèves, nous dit-il, la peau du monde est nue, beau cimetière sans pourriture. Tandis que d’autres récoltent aux Puces des objets mal aimés, c’est là que ce convive attitré de l’océan recueille ses épaves. Échouée sur le sable un beau jour lui échoit la dépouille d’un cul de chalut, qu’il ramasse, ravaude, retend pour ce « projet toujours mythique de la sculpture d’insuffler la vie, de recréer le vivant », pour en gonfler des bêtes fabuleuses à tournebouler les imaginations les plus folles.
Des fonds marins longtemps dragués ces cuirs ont ramené la fragrance des légendes englouties et des vaisseaux sombrés : les monstres de Raimbaud en sont comme imprégnés. « La peau, tissu commun à ses concentrations singulières, rappelle Michel Serres, déploie la sensibilité. Elle frisonne, exprime, respire, écoute, voit, aime et se laisse aimer, reçoit, refuse, recule, se hérisse d’horreur, se couvre de crevasses, rougeurs, blessures d’âme. Il faudrait apprendre à lire à livre ouvert l’écriture des dieux en colère sur la peu de leurs victimes. L’abécédaire de la pathologie se grave sur le parchemin.
Intérieure et extérieure, opaque et transparente, souple ou raide, volontaire, présente ou paralysée, objet, sujet, âme et monde, veilleur et guide, lieu où le dialogue de fond avec les choses et les autres arrive et d’où il brille, la peau porte les messages d’Hermès et ce qui nous reste d’Argos ».
Bois flottés, os rongés par les flots, ais de carènes, fermes de charpentes servent de squelettes à ces peaux tendues à craquer, humectées puis durcies au feu ou au vent de la côte. Voici donc qui nous change des matériaux ordinaires du sculpteur, terre, pierre, bois, métaux, plastiques… et qui nous confirme dans l’idée que la grande (ou la première) affaire pour le praticien consiste à trouver, à élire son matériau, son support, sa texture, son tissu de complicité. Un sculpteur espagnol n’a-t-il pas confectionné un Christ en peau humaine vénéré à la cathédrale de Burgos ? mais on trouverait sans doute de plus nombreux exemples de l’emploi du cuir dans les arts dits primitifs et exotiques. Les réactions des visiteurs de 1978 disent d’ailleurs quel tabou touche là Raimbaud !
Bien que notre olonnois se déclare sans sujétion à une symbolique tragique, Vieille Véruse, (1969 expression chaumoise signifiant Vieille Vérole) œuvre paillarde et joyeuse pour Suzanne de Coninck, « avec sa tête de cheval, se débride dans une Apocalypse des Temps Modernes » ; pour nous, ce serait plutôt un de ces massacres de cerf que les piqueurs tiennent dressé au dessus de la bête au moment de la curée.
Dans le même registre, Cahouenne vorace (1970) conçue pendant la guerre civile en Palestine, présente la carcasse et les viscères éclatés d’un gigantesque crabe en passe d’être absorbé par le sable du désert. Dans ces deux reliefs comme dans l’Oiseau mort (1971), qui grâce au syncrétisme du désir d’envol et de la peur de la chute se situe à la charnière des deux thèmes, Raimbaud réussit de façon saisissante la synthèse organique, la fusion de ses deux matériaux, bois et peau.
Le temps d’un printemps, celui de 73, les marronniers en fleurs du Luxembourg s’interloquèrent d’une Gargamoëlle aux Oyseaux fort peu sénatoriale. Mais les enfants de ce jardin – le plus accueillant de Paris sans conteste – y trouvèrent une antre de jeu, une symbolique à la mesure de leur fantaisie. La Gargamoëlle concrétise en effet superbement l’originelle antre vaginale, habitacle où le sculpteur aimerait convier les oiseaux. Cette sculpture où l’on pénètre et qui se souvient des refuges de l’enfance requit un arbre entier pour son ossature et obtint le prix du Salon de la Jeune Sculpture. Le regretté Denys Chevalier, qui hantait Paris sur son Solex et ne se piquait point d’art conceptuel, déplorait « ce vide incomblable, irréparable, qu’a laissé dans le jardin du Luxembourg cette Gargamoëlle aux Oyseaux aujourd’hui redevenue vendéenne mais qui fut, l’instant d’un printemps, lieu privilégié de ferveur poétique, jeu propice aux connivences enfantines et délectation d’un jury qui lui décerna son prix… »
« À ce propos, ajoutait-il, et cela soit dit sans offenser les précédents lauréats, faut-il convenir que rarement distinction fut aussi incontestablement méritée ».
« Merci pour le spectacle d’un enfant comblé ! » devait noter joliment une inconnue devant ces grappes de mômes fascinés par cette gigantesque outre rabelaisienne. Aujourd’hui où l’Éducation Nationale tend toujours à enfermer l’enfant dans un clapier fonctionnel, Michel Raimbaud, réfutant le théorème orthogonal, façonne cette antre baroque, retour aux concrétions du songe, caverne à claire-voie de la recherche intérieure. À l’inverse des Demeures ésotériques et impénétrables d’Étienne-Martin, la Gargamoëlle constitue un véritable habitacle.
« La maison tient l’enfance immobile dans ses bras » disait Bachelard. Quand à l’Éducation Nationale, elle admit à Olonne/Mer dans la maternelle René-Guy Cadou au titre du 1 % Neu l’olonnoise où se ruent à grands cris à chaque récréation les bambins de Prévert. Ces connivences enfantines ne trompent point…
Ces antres de repos et d’évasion, pleines de trouées lumineuses, qui de l’intérieur protègent et, chevauchées, ensorcellent, entraînent au voyage alchimique. Tout ce qui fut énorme en des temps surhumains, tordu comme un grand chêne entre ses mains fécondes, offre enfin aux chaluts un lieu de déshérence (ou déserrance). Nous sommes ici au centre de l’ambivalence du noueux et du noué, réalité ambiguë. Le rêveur utilise cette solidité du tronc robuste, centre autour duquel s’organise le paysage fantastique de Raimbaud fait de chaluts enfin fixés. La dureté ne peut rester inconsciente, elle réclame l’activité de peaux tendues jusqu’à la déchirure, images du réveil, fantasmes fluides.
Raimbaud ne redoute pas d’affronter les archétypes parentaux avec le Cri de la Mère et le Mur du Père, deux œuvres de 1974, entre lesquelles, ligoté puis ballotté, l’enfant va jouer son destin initial si dépendant. Dans le Cri de la Mère ou Maternité, le fœtus apparaît encore intimement relié à sa demeure utérine, qu’il ne quitte qu’à regret et tentera peut-être vainement de réintégrer. « L’abandon doit équivaloir, remarque le docteur Tomatis, par le passage de cet étrange défilé, à une descente vers le plus profond des chemins qui conduit au bord de l’Achéron ». C’est bien ce que nous suggère cette sculpture, étrangement proche des Deux Formes (1934) d’Henry Moore en bois de pynkado où règne une sollicitude empreinte d’inquiétude. Ici le nouveau-né est encore enserré dans les replis du lien ombilical – le vieux serpent de la Genèse – dont la section va bientôt l’obliger à happer l’air environnant, dans un sursaut vociférateur.
À peine affranchi de ce lien, le voici en butte au Mur du Père, que Raimbaud dresse devant lui tel un gigantesque épouvantail aux ailes déployées, aussi menaçantes que protectrices, refuge et rempart, image caricaturale mais éclairante du père gréco-latin, investi du droit de vie et de mort, qui acquiert « une potentialité de domination pour réagir à l’attitude possessive de la mère ». Contre lui se serre l’enfant apeuré, attendant plus ou moins consciemment qu’il abandonne ce rôle de singe dominateur pour devenir un véritable initiateur, un vecteur social. « Mon esprit mis en pièces se sent reconstruit par une perception soudaine, éprouve Virginia Woolf dans les Vagues. Je prends les arbres, les nuages à témoin de ma complète intégration ». Arbres, nuages, telles sont en effet les deux composantes fondamentales de la sculpture raimbaldienne. Comme si les premiers avaient fixé les seconds dans leur course vagabonde.
Et sur chaque forme frissonnante, la peau, vaste drap onirique, descend avec la violence d’une tempête.
Philippe Comte.
RAIMBAUD
VACHERIES
Galerie GALARTE – Paris
Du 21 avril au 15 mai 1982
Textes : Droits réservés.
Henry-Claude COUSSEAU
Les cuirs de Michel Raimbaud ont cessé leurs prodiges. Ces corps déchirés, dressés, connaissent maintenant la raison de leur torture et celle de leurs anamorphoses. Ils entrent dans la métaphore et dans sa jouissance : le corps, ou l’objet, comme dispositif d’échange et de rupture, entre son lieu de gestation et de dispersion, autrement dit, sa réalité et son obscénité dérisoire.
Le thème originaire de son travail, c’est dans son adhésion à l’œuvre de Chaissac que Raimbaud l’affirme tout d’abord : ses matériaux humbles, naturels et quotidiens, son caractère anti‑académique, organique et fusionnel. La mer lui livre les bois flottés et le port les cuirs de chalut. Mais c’est pour décrire un corps antérieur, dans l’épuisement de sa genèse, ou dans l’extravagance de ses pulsions, couturé, déchiré ; ou encore en désigner l’antre originel, le poids gravide.
Lieux d’une germination sauvage, terrible, d’une organisation qui tente de se faire, les premiers travaux en exhibent toutes les strates et les étapes. Ils exposent la lenteur et la confusion du genre ; des analogies qui mêlent la tension au vide, l’érection à la mort. C’est au prix de cette remontée que la reconstitution, que la possession du corps a lieu, dans l’assurance du camouflage, dans la peau.
Mais ce recours fantasmatique installe une persistance. Sans doute les travaux de Raimbaud tiennent-ils leur violence et la qualité de leur déplacement au délire incessant, monodique et lancinant qui les conduit. Les anamorphoses de la fusion, cette alternance rhétorique des contraires, miroir du ressassement du monde, ici le manipulateur en joue comme d’analogies perpétuellement renvoyées à elles-mêmes, strictement enfermées dans un parcours répétitif, obstiné et pulsionnel.
Ce fantasme, porteur de l’énigme initiale et de ses tératologiques questions, Raimbaud en a donc fait l’épreuve et aujourd’hui il en aborde la métaphore dans un langage qui a déplacé l’incidence de sa désignation. Dans des formes et des façons qui recourent à la même logique, à la même exigence syntaxique, mais dans la qualité d’un détour, d’une distance, qui les entraînent vers d’autres sens, ou qui peut-être les ramènent tout simplement à leur irruption primitive.
Hier, des bois, vécus par la mer, transfigurés par la mort, calcinés comme l’os. Des peaux, tannées, fendues, coupées, qui s’épuisaient d’une perpétuelle génération. Aujourd’hui, les ondulations souples et lourdes du seul cuir, proliférant, recouvrant, libéré de ses assises et livré à lui-même. Comme le passage d’une dramaturgie à la vie même ; de l’énigme au consentement.
L’anamorphose ici assure la reconduction incessante de la jouissance et de la fusion. Elle gage, dans le bercement de ses plis, dans la volupté de leur respiration, tous les futurs et tous les apaisements, en les comblant, en les attisant.
Ces vides ont été des corps ; ceux-là les portent. Quant à ces blocs dépolis et figés, ils promettent ici un poids secret, sourd. Dans une incessante récidive ; dans un temps écarté, indifférent.
Henry-Claude COUSSEAU
Texte : Droits réservés.
Michel RAIMBAUD
Les chevaux avaient droit à n’être que bridés, un aide les émouchant.
Les pauvres vaches beuglaient souvent
l’une encore au long de l’aiguille
l’autre au sacrifice
hissée par deux sangles sous-ventrières enroulées sur un tambour de bois à cliquets sonores manœuvré à la barre de fer la tête sous le joug immobilisée lentement par une lanière de cuir chromé de taureau multicroisée autour de cornes et du crâne
Trois pattes brêlées au plus bas le long des montants, pauvre sac de tripes pendu au plus haut pour aucun appui, la quatrième révulsée pour le ferrage du métal chaud sur de la corne fumante.
Puanteur douleur soubresauts impuissants coup de gueule antiseptique en bouteille, premières images de la souffrance au TRAMAIL de l’oncle octave, restes d’odeurs dans les sangles, suint poils blancs gras qui nous servaient de balançoires à chaussons par dessus la bouse verdâtre que les bêtes avaient lâché d’épouvante.
1er mai 1982
Michel Raimbaud
Texte : Droits réservés.
Folles Vacheries et Belles Gabares
Exposition au Musée de La Roche-sur-Yon
8 juillet – 1er octobre 1995
Textes : Droits réservés.
Grande planète - Laurence Imbernon
Michel RAIMBAUD se fait fort de rappeler dans l’histoire de sa sculpture ce qui l’a rapproché de Gaston CHAISSAC, qu’il rencontra pour la première fois en 1953. On ne doit y voir là qu’une forme de modestie : Michel RAIMBAUD ne parle jamais de son «œuvre», de son «travail», de sa «sculpture». Comme s’il était gêné de donner un contour et un nom à ce qu’il fait depuis longtemps, peur de se figer et d’être piégé par la fixation. La vie est toujours en travail.
De Gaston CHAISSAC, on peut lui reconnaître une certaine ivresse à s’emparer d’objets repris, déjà exploités dans leur forme et leur symbolique, auxquels il va donner un autre totem. Mais la récupération prend un tout autre sens chez Michel RAIMBAUD. Il trouve les Culs de chalut et les bois flottés. Il cherche «l’expression possible d’un monde où le Cuir et le bois, peau de corps, s’approchent de l’essentiel». Au matériau qu’il a choisi, inventé, c’est-à-dire la Peau de vache tannée ou le cuir des Culs de chalut, il va associer une mythologie que l’on pourrait dénommer fantastique. Une féminité primordiale agite la cosmogonie qui regroupe les grandes sculptures, féminité de la naissance (de l’humain mais aussi de la nature) à laquelle l’artiste rend grâce sans l’enfermer dans une symbolisation facile.
La sculpture est une matière et en même temps une surface ou bien encore une cachette dans laquelle grimpent les enfants. Du monumental, Michel RAIMBAUD retient l’aspect de la construction, de l’abri ou du chariot. Voici d’ailleurs le passage idoine pour parler des mots dans la sculpture : l’idée du chariot fait émerger à notre intuition celle de la Grande Ourse ou peut-être du Grand Véhicule. Mais tout cela reste en nuances, car le matériau rustre rappelle son exigence, en même temps qu’une certaine propension à figurer quelque chose.
S’il hésite à nommer art ce qu’il fait, Michel RAIMBAUD ne lui en donne pas moins un prénom, un titre qui ressemble déjà à une fable. Rabelais est là, dit-il, par sa truculence, la dimension à l’énorme et le sensuel. Mais aussi Villon, plus sombre et profond.
Il restait à confronter aujourd’hui ces belles idées et ces formes généreuses à la dure scène de l’exposition. Exposer, c’est tout à la fois exciter son narcissisme, pour un artiste, et lui retirer toute protection contre le regard des autres. Le pari est tenu dans les salles du musée et c’est avec le plaisir que nous avons escompté que nous découvrons de nouvelles Grandes Gabares, d’autres Culottes et une peinture de cet Irrégulier* de l’art qui, invariablement, suit son chemin dans le bel aujourd’hui.
Laurence IMBERNON
Conservateur du Musée
* Michel Thevoz
Texte : Droits réservés.
Entretien avec Michel Raimbaud
Plutôt que de procéder par questionnement sur votre œuvre, vos aspirations et vos préoccupations actuelles, je vais lancer des mots, des noms… Celui d’Élie Faure, par exemple.
Michel Raimbaud : Elie Faure ? Maintenant, je me sens bien plus proche de Michel Serres, l’écrivain des «Cinq Sens» du «Parasite», des «Hermès». Tout à la fois rugbyman, officier de marine, universitaire des sciences et des lettres, son savoir embrasse toutes les formes de la connaissance. Qu’il parle des Portes de l’Enfer de Rodin, du Balzac de «la Belle Noiseuse», la mer est toujours là, ce grand Utérus sauvage qui change sans cesse d’état et de couleur, des grands calmes à la mer énorme. Sa profondeur reste le contraire d’un espace social et certain. Il n’y a pas de trace sur la mer et celles qui sont là ne proviennent que des humains. En mer, la nuit, c’est la lune et les étoiles qui roulent et qui tanguent au gré de la houle. La planète est immense, mouvante et ronde. Le bateau et mon corps «nagent».
A la différence du marin, l’agriculteur imprime un sillon sur la terre, cette trace de mort. Je me situe en frontière de ces deux mondes, de ces deux planètes et j’aime l’analogie avec Michel Serres qui, entre son parcours littéraire et scientifique, est descendu de la montagne vers la Garonne.
Souffrance ?
Celle de la chair. Les lanières de cuir bleu tanné que je confectionne inquiètent ces mêmes enfants qui mangent leur bifteck. Il y aurait dans ces lanières une connotation de chair vivante, blessée, dépouillée. Il est vrai que lorsqu’on pèle un animal, il y a là un acte répulsif. Est-ce un détour ou une faute de ma part ?
Avant les cuirs, dès 65, j’ai peint une épave en carcasse ouverte, puis sont venus les culs de chalut, ramassés sur les côtes. La bête n’apparaissait pas dans ces sculptures, ni dans la forme ni dans un intérêt de représentation. Je n’aime pas les poules ni les vaches ni les lapins écorchés et s’il y a une idée de souffrance, ce serait alors, de ma part, un non-dit sur la guerre, les morts, les gens sous les décombres. Je suis un anxieux mais je crois avoir expatrié le statut de la bête écorchée. S’il y a souffrance, c’est une extrémité, la bête est refoulée. Le cuir est un superbe matériau, pour moi évacué de toute idée de mort. Et dans mon travail, le fait de la mort n’est pas plus important que le matériau vivant, pas plus que la jouissance.
Le cuir sec, c’est un résidu dur et qui dure: qui franchit les étapes de la mort, pour devenir, pour la jouissance du sculpteur, un objet sec. Il a un rapport avec la lumière, le désert, au contraire du mouillé, de la pourriture. Mais le mouillé, c’est aussi la mer. Rien n’est simple…
Associations d’idées ?
Elles sont pour moi plus musicales que fondées sur une anecdote. Par une anecdote, on donne un sens, quelque chose qui a lieu. C’est cette musique qui fonde les titres aux vocables patoisants, terrestres ou marins. Ces mots sont porteurs d’imaginaire, comme ceux de Rabelais qui ont gardé dans leur chanson une joie : alliance agréable de dire des voyelles et des consonnes. Des mots qui ont une liquidité, qui passent par la bouche. Érotiques, poétiques, les sonorités ont à voir avec le voyage. C’est ce qui fait la différence entre «halte» et «alt»… Le mot Gabare, par exemple, a son histoire. C’est scarabos, crabe et bateau rond en Grec, escarbote, Gabare, bateau de fleuve. «Ton père a-t-il un canote ? Que not, mais l’a une gabare a fond plat’ sur la chnoue».
Une Gabare est un objet mal défini, dont l’appellation est plus grande que le bateau. C’est comme le corps du marin : le bateau est son costume, son outil. Il l’habite et s’en sert. Les coracles irlandais sont encore faits de peaux de vache.
Mes Gabares sont folles, elles relèvent d’une certaine folie, celle des cabanes perchées : l’homme a un rêve d’oiseau autant qu’un rêve de poisson, les lieux qui lui sont interdits l’enchantent. Je l’associe au symbole de la charrette volante : fondamentalement, je vois : partage-habitation-instrument du mouvement du corps. C’est Vinci et l’homme dans sa roue. Aller à la pêche de ses territoires.
Modernité ?
Les vingt-cinq de la jeune sculpture avec Étienne Martin dans les années soixante-dix. Je me sens en panne pour passer de la modernité de Baudelaire à la post-modernité. Je remarque deux choses : chez l’homme, il y a toujours permanence et mutation. Permanence avec les naissances, morts, souffrances.
La modernité se situerait dans le second domaine. Mais on ne pourra jamais évacuer la pérennité. Le début du 20e siècle l’illustre en sculptures, entre autres celle du Balzac de Rodin, du Ready-Made de Duchamp en passant par La Colonne sans fin de Brancusi.
On saute en 20 ans dans le 20e siècle.
On établit aujourd’hui des rapports sociaux et intellectuels vis-à-vis de l’art.
Est-ce que ça suffit de décréter ? J’ai besoin de la virtuosité de la facture, d’une exécution de qualité. Mon exécution n’est pourtant et surtout pas esthétique.
La facture, à l’opposé du discours, détourne le monde.
Ma vision du monde, c’est que les Peaux de Vache n’existant pas dans leur nature, leur invention ramène à elles l’humanité, les végétaux, les minéraux, les météores.
Le langage ?
Le langage est encombrant. Heureusement que les mots ne viennent pas les premiers. Mais par exemple, cela me gêne toujours qu’il y ait des «sans titre».
Apparition de la couleur ?
Je ne sais pas, ce serait une envie de peintre. La couleur, je la convoque. Mais dans la sculpture, la couleur n’apporte pas une part essentielle. Le bleu des sculptures, c’est le bleu des sels de chrome. Cette couleur s’allie au ciel et à l’océan. Sa pâleur m’est plus silencieuse, l’oxydation possible l’approche de la tempête – je rêve d’une sculpture muette et sauvage. Comme la Noise de mer, ma sculpture grimace et mugit. N’est-ce pas un signe de ma nature ? Peut-être me quittera-t-il ?
PEAUX DE VACHES ET FOLLE GABARE 7
Musée des Beaux-Arts – Nantes
Du 18 mai au 3 septembre 1979
Textes : Droits réservés.
Claude Souviron
Le Musée s’ouvre à Michel RAIMBAUD. Et, immédiatement la mer et tous ceux qui, poètes et musiciens, l’ont évoquée s’y engouffrent à sa suite.
Et ce n’est pas l’un des moindres mérites du « sculpteur » que de nous le faire sentir, nous empêchant invinciblement de taire qu’une houle de sons nous saisit devant ses œuvres.
Certains puristes nous reprocheraient de citer des noms illustres, des vers fameux, des mesures lyriques exaltantes. Nous laissons donc au visiteur le plaisir de les sentir affleurer à sa mémoire, celui de rechercher le livre ou de poser l’aiguille sur le disque parce qu’il a vu, parce qu’il a éprouvé.
En effet, comme de plus en plus souvent maintenant il ne suffit plus de voir, il faut avoir éprouvé, utilisé pour « comprendre ». Plus encore, il est impossible de « comprendre » ce que réalise Michel RAIMBAUD sans avoir « joué » de ses œuvres, sans y avoir intimement participé, sans en avoir pris possession.
Un artiste ne se « donne » pas à ce point du premier coup. Et lorsque nous vîmes pour la première fois des œuvres de Michel RAIMBAUD au musée (c’était il y a huit ans à « Bretagne 71 »), un tempérament riche se révélait, maître d’une technique originale, mais nous ne pouvions prévoir l’ampleur de ce qui, très rapidement, croîtrait.
Dès 1973, cependant (toujours au « Bretagne »), nous avions « la Gargamoëlle aux oyseaux » et ce fut un intense plaisir de l’admirer, de la manier.
Et tout d’abord, il fallut la faire entrer au Musée par la seule voie possible, la porte de la Bibliothèque Municipale, rue Gambetta. L’étonnement des passants, assez vite attroupés, donnait à se réjouir. Nous nous rappelons celui qui, parmi eux, nous posa la question rituelle : « Qu’est-ce que cela représente ? » et comprit lorsque nous évoquâmes la cabane que tout enfant construit ou rêve d’édifier. Et des enfants, déjà, avaient joué avec « la Gargamoëlle aux oyseaux ».
Il y aurait eu et il y a plus à dire que la simple « cabane » que le jeu élémentaire si émouvant soit-il. Il y a le nid, le berceau, l’abri souterrain, terrestre ou aérien, l’arbre, le cuir, la peau. Plus profonde et essentielle encore il y a l’intime caverne où se forme l’homme.
Enfin, il y a ces coques dont il a besoin pour, sortir de l’abri, tenter toutes ses aventures sur terre, sur mer, dans les airs, dans le cosmos.
Nous pouvons réfléchir de longs moments à ces abris et aussi aux vêtements de peau lacée, à cette épopée dédiée par le sculpteur à ce qui nous protège, à ce qui est le plus précieux immédiatement, notre peau.
Il faut y être « bien » pour pouvoir presque en sortir, se risquer, se « donner » (nous y revenons).
La série des « Folles Gabares » est le « don » que nous fait Michel RAIMBAUD d’une « coque » gréée pour l’aventure. Il faut l’entendre parler des « Folles gabares » comme de navires, il faut avoir vu les enfants jouer dans celle qui se dressait sur la place des Sables d’Olonne et qui résista à la tempête.
Certes nous espérons que le Musée ne sera pas soumis à pareille épreuve, mais il fera penser à une plage ou à une aire de jeux. Notre salle offre plus encore que le plein air et notre « Folle gabare » est la plus haut gréée de toutes. Les arbres flottés sont ceux que la mer a polis et rejetés. Assemblés, ils sont montés comme une mâture qui aurait poussé, libre, selon une dissymétrie voulue intérieurement par l’artiste et rééquilibrée à chaque instant par un mariage harmonieux d’instinct et de volonté. Les peaux glauques sont lacées de cuir ou encordées selon un dessin qui les tend comme des voiles. Les mots de volume ou de sculpture ne sont plus rien, celui de structure serait un peu froid pour ce vaisseau dont il semble qu’il va s’envoler et nous entraîner dans quelque féerique voyage.
Il faut répéter que nous éprouvons la même fierté qu’avec MORELLET ou RAUTENSTRAUCH et que nous souhaitons que des artistes (nous en connaissons déjà) occupent ainsi notre salle, et offrent un tel travail au public.
Car il s’agit encore d’une construction éphémère, l’artiste lui-même, et son équipe (bien sûr une œuvre d’une telle dimension ne se réalise que collectivement), démâteront, délaceront, démonteront. Mais nous aurons eu le temps de rêver, comme Michel RAIMBAUD nous y invite. Comme lui nous ferons retour aux origines de notre être, puis nous tenterons l’aventure grandiose pour laquelle nous sommes créés.
Claude SOUVIRON.
Michel RAIMBAUD
Sans doute me souvient-il!
du premier ventre,
de la maison, du jardin,
de l’atelier aux outils mystérieux,
de mes jeux, bricolés de ferrailles et de bois,
de l’histoire, des légendes – Gavrinis et les cathédrales -et
CHAISSAC en paysannerie peinte.
Ici et maintenant,
le chant des grèves
après la ville et les villages,
où ‘les arbres s’arque-boutent,
le sel brûle la fleur,
le crabe crève au sec :
Patchwork de temps et de matériaux hétérogènes.
REGARDE !…
… oui, avec tes mains !
le bois qui se découpe
sur ce fond de roches brunes.
Il est pâle – gauchi par le flot
du temps – depuis ce temps où il t’attend.
Respire son chant d’iode,
enveloppe -toi de son appel,
touche sa robe, aux dessins d’herbes folles,
mémoire de ses racines.
A pleins poumons, pénètre-toi de lui,
raconte-lui ton vouloir
afin qu’il te respire
et qu’ensemble
vos cœurs chantent à l’unisson.
Laisse-le te guider
à son équilibre tranquille
Que ton bras soit sa branche.
Et, tel qu’il aurait poussé…
…laisse-le …se poser…
Pour qu’à ce temps
il te montre, toute vergue au ciel,
l’ouverture aspirée…
…issue vers l’inconnue !
TU n’es plus vertical !
TU es oiseau !
TU es appelé, toutes ailes dehors !
…une fois de retour…
TU N’ES PLUS LE MÊME !
Des lieux investis en première aventure :
Folle gabare au fond d’un puits, au musée des enfants,
sous les arbres du parc de Tessé,
dans la ville, au pied des tours de La Rochelle,
sur les rochers de Tanchet, parmi la foule d’été,
dans le sable de la grande plage,
brisant à la mer la tempête du solstice.
Des mattes folles d’enfants !
grimpent, sautent,
tanguent et roulent,
expérimentent de nouvelles gîtes
renversant ainsi l’image traditionnelle
de l’aplomb normalisé continental.
Tout en visitant, à plein corps,
en risque physique,
le chemin qui leur est donné,
ils accèdent à certaines régions de l’œuvre
fermées à mes possibilités personnelles,
et projettent une puissance supplémentaire
féconde au futur de mon travail,
et de leurs souvenirs.
Que jaillisse !
en eux et par eux,
une immense promesse !
Construire de l’insolite – du méconnaissable –
ÊTRE méconnaissable
Travail de force à vide de pensée
pour accepter du lieu
la voie qu’il nous ouvre.
Faire avec et en lui.
Bricoler de nouveaux langages,
dans l’ornière des vieux clochers.
Paysan, marin
aveugle du cœur de la Terre ou de la mer qui les porte,
mes mains sous la peau,
vos yeux sur la peau.
Sac de tripes molles sur mes bras,
mes doigts cousant l’envers du décor .
… Seule, la charpente de cœur
est claire à nos yeux,
dressés comme la licorne
vers la verrière du patio de Nantes.
En recherche d’alliance du bleu de l’air,
la peau se tendra
seule
et dessinera
son visage.
Michel RAIMBAUD
1979
La Folle Gabarre III
Exposition au Musée de Tessé – Le Mans
4 mars – 10 avril 1977
Textes : Droits réservés.
RAIMBAUD le Vendéen : Poète et marin - Michèle Bordier-Nikitine
Prétendre parler de RAIMBAUD qui est le verbe même voilà qui est redoutable et à la limite prétentieux… Comment décrire ce poète – non pas l’Arthur des Ardennes, mais Michel (Charles, Louis, Alcime) le Vendéen – quand le second emprunte au premier ce déferlement irrésistible des images ? Comment évoquer la « Gargamoëlle aux oyseaux » ou la « Folle Gabarre » avec nos mots de terriens qui pèsent ? Comment dire RAIMBAUD qui est une saga à lui tout seul ? Ecoutez plutôt :
«
Un lieutenant de la garde impériale
une sage-femme un tisserand
un étudiant ecclésiastique
devenu expert-géomètre et pêcheur à la ligne
un vigneron des paysans,
deux forgerons une mémé d’avant le pétrole
et un père ébéniste d’avant-guerre
m’ont légué une Vendée républicaine…
…
fils d’ouvrier promu instituteur
animateur de culturelle culture
…
on se fait un plaisir d’amour en peau
de vache de cul de chalut mesdames
trituré couturé sur polis bois flottés… »
Et vous voilà fixé désormais…
car ce magicien ès-verbe – non pas du verbe savant et pédant mais du langage tanguant et chantant des marins vendéens – ce conteur-né est fils de la matière et magicien en cuirs et bois.
Fils d’ébéniste et de couturière, neveu de forgeron et petit-fils de paysan vous chercherez en vain un bourrelier dans sa généalogie et c’est pourtant le cuir qu’il a élu ; parce qu’on ne coupe pas le cuir comme un carton : on y taille dans le vif, le vif de notre peau, le vif de notre chair, et c’est sans doute pour cela que l’œuvre de RAIMBAUD nous fouaille si profondément.
Entre le cuir, le bois et lui ce fut une rencontre au large… elle s’était échouée sur la grève, peau de vache de cul de chalut, entaillée par les fonds rocheux, percée, déchirée, rejetée par les flots, épave. La ramasser et la recoudre ce fut un geste instinctif. Et c’est ainsi qu’a commencé son ravaudage à vif qui rattache le bois et le cuir, l’os et la peau. Écorchure, entrailles et cicatrices toute la démarche d’un chirurgien aux doigts de poète.
Comment la peinture et son léger support pouvait‑elle résister à cette force tellurique et marine conjuguée ? RAIMBAUD ne balança pas longtemps et il opta pour la matière vivante qui exige une lutte physique (essayez un peu de tendre ces fameuses peaux de vache qui en séchant arrivent à briser leur support même). En fait, il opta moins qu’il ne tomba amoureux. Et il fit corps désormais avec ses peaux et ses bois… avec lui-même.
Voir la Gargamoëlle, la Folle Gabarre ou le Reître écorché c’est voir RAIMBAUD : acuité du regard, force du geste, sensualité du verbe et le souffle… ce souffle qui est la respiration même de l’océan.
Pourquoi ces formes ? Pourquoi le cuir et le bois ? Et à quoi ça sert ? Et qu’est ce que ça représente ? Et pourquoi ? La réponse fuse aussitôt « parce que je suis vendéen ». Imprégnées de sel, pénétrées de vent et d’océan, alliées aux ailes des oiseaux et des crêtes des vagues, aux voilures et aux nuages, aux galets et à la grève, au flux et au reflux, ses œuvres sont un élément de plus qui s’intègre à la côte.
Lui, il s’est fait marin et il a épousé leur langage : truculent et coloré, toujours prêt à la démesure comme la mer qui s’enfle tout d’un coup, contant au rythme chantant qui accompagne le mouvement de la mer. Il faut également voir RAIMBAUD marcher ou plutôt foncer sur l’objectif ; il y a du taureau chez ce natif du Lion, mais un mouvement balancé qui signale l’homme de la mer, équilibre sa force.
Son univers ce sont les marins de la Chaume buvant jusqu’à plus soif, racontant jusqu’à plus voix et passant par-dessus bord quand la mer se fait garce. Au fond attendent les crabes, sur la jetée les femmes et les amis et au cimetière quelques tombes de plus… vides.
Et l’œuvre de RAIMBAUD dans tout çà ? Mais l’œuvre de RAIMBAUD elle est tout ça précisément, vous n’avez qu’à regarder en l’écoutant…
Et vous verrez des cuirs sombres tendus sur des bois noueux qui saillent comme des muscles trop durs ; la plupart ont fait le « grand voyage » os dépouillés de leur chair par le fleuve et trempés – comme est trempé l’acier – par le sel de la mer. Puis il y eut les cuirs bleutés parce que la Vendée c’est également beaucoup de lumière – et la Folle Gabarre prit le large, volant à la rencontre du Bateau Ivre…
On pourrait analyser, psychanalyser, élucubrer ou poétiser ; d’autres s’en sont chargés avec beaucoup de talent; sachez seulement que de théorie esthético-philosopho-structuralo-conceptualiste il n’en a pas, il est bien trop philosophe pour ça ; que l’esthétisme il avoue s’en moquer royalement ce créateur d’essentiel, ce qui l’intéresse sérieusement c’est la relation du corps humain avec la structure de ses œuvres – un incurable anthropomorphe en quelque sorte – Les dites œuvres se font d’ailleurs de plus en plus ludiques et RAIMBAUD n’est jamais aussi heureux que lorsque la Gargamoëlle est pleine d’enfants à craquer et qu’ils s’accrochent en grappes aux mâts de la Folle Gabarre qui leur est forêt et navire, grotte et sein maternel.
RAIMBAUD C’EST AVANT TOUT LA VIE MULTIPLE ET GÉNÉREUSE.
Son but, ne plus s’ancrer que sur les grèves et faire s’affronter ses œuvres à l’océan, pour de bon, pour de vrai.
D’ailleurs, il arrive que RAIMBAUD renvoie une de ses œuvres à la mer… Gardez ceci à l’esprit et relisez le Bateau Ivre vous serez frappés de la similitude de leurs dérades.
Michèle BORDIER-NIKITINE
DÉMARCHE D’ENSEMBLE - Michel Raimbaud
Ramasser ce qu’on trouve d’objets merveilleux… au bord des grèves la peau du monde est nue, beau cimetière sans pourriture ; la foire mondiale à gueule d’abattoir y présente un visage plus serein mais aussi plus vrai. Tout un monde, mon monde, le MONDE…
DÉMARCHE D’ENSEMBLE
Depuis 1958, Michel RAIMBAUD a une approche étroite de la mer ; Il subit également l’influence de Gaston CHAISSAC avec lequel il vit une grande amitié. À partir de cette époque : peinture sur support actif, naturel et non vierge ; choix de CUIRS de culs de chaluts usagés, marqués de la TRACE des déchirures et des blessures des coquilles et des fonds marins.
Écriture plus naturelle et adéquate au matériau : trous, couture des accidents de la peau, sans sujétion à une symbolique tragique, par plaisir presque ; ajouts qui semblent aller d’eux-mêmes : bois flottés, qui sous-tendent la peau et restent dans l’ambiguïté : os, mâts, étais, asémie ou polysémie peu importe. Pas de problème non plus au niveau de l’insertion au réel : titres d’œuvres plutôt musicaux que signifiants, cadences à l’image du langage des marins, aux scansions de la mer, flux, reflux, ressac…
Du format plat, passage progressif au relief mural, au totem, à la « Cabane » creuse, habitée ; le corps et le cœur (enfants, adulte, couple) vivent dans un organe, mais aussi dans la maison de l’air : autant d’issue que de paroi. C’est l’anti‑boîte, à une époque de la mise en boite généralisée.
La Cabane s’ouvre aux oiseaux, au vent, à la lumière : FOLLE GABARRE, plus objet-jouet à grimper, à sauter, ramper, suspendre, caresser, construire… que bateau ivre : peau de taureau neuve, bleue très claire tendue à rompre sur des bois blancs qui aident à être BIEN dans et hors sa peau ; Quant à moi je me fais d’abord plaisir.
Michel RAIMBAUD
(Janvier 1977)
MATIÈRES – « nœuds »
Revue Verso
Mars 1990
Textes : Droits réservés.
Sculptures Rimbaldiennes - Claude Poulain
Matières jalouses de l’âme, substances éprises d’idéal et d’intuition, cuirs et bois qui se voilent et se dévoilent comme des masques tournés vers eux-mêmes.
Cuirs et bois ! porteurs inconscients mais en attente, non résignés, qui ne demandaient qu’à partir vers d’autres horizons, d’autres aventures, qu’on se souciât d’eux …
Bois et cuirs ! qui vont se mêler et s’entremêler, se jalouser inconsciemment, avant d’être unis dans des formes neuves, imprévues, imaginées dans un baroque frémissant, comme un ciel d’orage, comme un remous d’ombres lourdes ou furtives.
D’abord était la branche, le tronc, ou la racine, arrachés à un espace prémédité, envisagé, formes décharnées, désincarnées – entendez-vous déjà les promesses des mots convenant de chairs et de viandes protégées de peaux ? – que la mer roule et tourne, use et patine : meules sempiternelles d’eaux et de sable, surprises des chocs bruts.
Échoués mais non noyés, ils gisaient comme projets d’êtres sans mémoire, perdus dans les feux du matin ou dans les grisailles du soir, jusqu’au moment de se sentir saisis, agrippés ou agrafés pour l’imprévisible rendez-vous, la rencontre substantielle : le cuir les attendait.
Cuirs élimés, rognés, mordus, déchirés, des vieux culs de chalut qui ont longtemps trimé dans les bas-fonds marins et qu’on abandonne alors, en rebut, sur les quais.
L’heure est venue, livrés aux décisions, aux initiatives du maître d’œuvre, des tensions et des croisements, des enlacements et des entrelacements. L’heure sera celle du lacet de cuir et de la spirale du foret imparable, qui vrille et qui alèse…
L’heure est venue du lien qui rattache ou qui ligature, dans un état d’interdépendance : unions et réunions, aboutages, épissures…
Nœuds ! qui vont vous donner naissance ! Nativité puis indépendance. La sculpture se constitue. Elle se dégage lentement pour apparaître dans sa nouveauté, dans son mystère, accompagnée de cent questions, déjà prête pour les controverses.
C’est la gabare savamment carénée et à l’ample voilure, porteuse de rêves et d’espoirs fous, apte à la conquête d’horizons insoupçonnés, et propre à tous les dépassements. Vaisseaux pour gabiers hors de sens, capables de s’envoler après avoir pris le large, qui font renaître en nous les pulsions de l’enfant.
Mais elle ne se contentera jamais d’être. Elle exigera et éprouvera, elle suggérera et insinuera. Comme oscille l’homme au cœur d’un monde sans pérennité…
Significations proliférantes, mélangeant doutes et angoisses, délires et pulsions mystiques, prémonitions et visions d’avenir…
Liens, par la grâce non innocente des nœuds, qui peuvent, selon la circonstance, devenir lacs et pièges, boucles de vie ou nœud coulant du pendu… à moins encore qu’on envisage la cravate, ou celui aux deux bouts en aile de papillon.
Le nœud n’est-ce pas aussi la parure ? A moins encore que ce ne soit le point marqué pour le début des rapports humains : celui de la rencontre, ou celui, central, d’une affaire, l’intrigue, s’entend, plus que la péripétie; plus loin encore apparaît celui des ramifications, puis celui des vibrations…
Mais assurer le garrot, la sangle, ou l’assujettissement ne saurait suffire, contenter le nœud. Il est aussi saillie, protubérance – avec parfois une volonté de protection – un renflement, aux confins des spirales ou des entrelacs. Qui annoncent de nouveaux départs… Il peut se faire rotule et commander aux tibias, il peut se faire tendre et envelopper de douceurs étranges ou voluptueuses; il peut se durcir et devenir noueux comme chez le vieil homme et le vieux chêne.
Parfois aussi il saura se limiter au rôle redoutable de joint.
Rivalités muettes et obscures des matériaux, qui vont s’entrechoquer, puis se résigner à n’être pas élus : exigences neuves de l’invention, de la création. L’artiste abandonne ou rejette alors la forme trop rigide ou mal adaptée du bois.
Pour un temps, il sélectionne d’inhabituels participants, qui vont entrer en scène et qui s’imposeront, porteurs de nouveaux fantasmes, ou riches d’une réalité oppressive.
Voici le temps des cuirs lourds, de taureaux ou de bœufs, semblant appelés pour d’inédites carapaces, confrontés aujourd’hui aux galets tant et tant roulés par la mer durant ses moments de fureurs et d’émois. Cette mer matricielle aux abysses souverains que survole l’albatros et le stercoraire.
Imbibé d’eau, le cuir devient malléable et docile. Sous le poids têtu des galets, aux rotondités choisies, il se tend, se modèle, se façonne et se fouille. Comme la peau humaine sur l’os ou l’articulation, comme l’antique cuirasse sur la poitrine du guerrier.
Les cuirs bleuis, vert-de-grisés tel le bronze à la séculaire patine, tannés au chrome, se font coques creuses, résonnantes, monstres inhumains débarrassés d’humeurs et de viscères. Antres qui serviront de repaires à mille et une imaginations. Cavernes inquiétantes et mystérieuses dont on doute de jamais pouvoir sortir. Et pourtant…
Vertiges et attractions du précipice. Cavités énucléées qui cependant s’entêtent à vous observer. Oreilles aux pertuis gigantesques, à l’écoute de l’inaudible, du passé au futur…
Attractions magnétiques avec leurs influences occultes, si puissantes, envoûtements et fascinations. Grottes primitives qui se perpétuent ou objets cosmiques, venus du vide intersidéral sur un rayon de lune et prêts à y retourner ?
Créer ! Michel Raimbaud, en artiste vrai, pressent, tire du néant et donne vie. Il tente de triompher du temps et de comprendre en conférant une forme à ses fantasmes. Il enquête, il explore, il sonde et poursuit inquiétudes et interrogations proliférantes, trop souvent muettes. Sa sculpture emprunte aux associations d’idées, aux symboles. Et sa force, son esthétique, sa puissance évocatrice, naissent d’une recherche jamais démentie, guidée par une intuition sans défaut.
Claude Poulain
Texte : Droits réservés.
Pour Michel Raimbaud - Jean-Damien Chéné
1
Ravaude coud
la mère
et la mémoire
couture
entre ton enfance et la mienne
sable et vent
et quoi
D’un coup de la dent
au ras des tissus
de la peau
au coin d’un feu
nœud peu
visible
Le soir en cercle
nous lisions
mots lus et entendus s’entrelardaient
sous la lumière tamisée
de l’abat-jour et du pare-feu
Au bord de la cheminée désormais
cendres
et les quelques braises d’un nom
Si je quitte les joues brûlantes
la trop grande proximité du feu
grand froid dans la chambre Dehors
grand vent
Dans la nuit
la fenêtre s’ouvre ma mère
répond J’entends
sous mes couverture l’appel
au secours ne vient pas de moi pourtant
dans mon sac-à-pieds je grelotte Les mots
«le docteur ira’’ mon père
sont pour les autres
nœud peu visible quel coup sec
d’une torsion de la lèvre des dents
t’a fait
que l’homme dè l’art en soit fier
une si belle cicatrice
2
Trop de nœuds trop
de traces pour qu’en chemin
ne se défassent
ceux que je lace
( ou quand la mer
en nous se retire
que le sable dans la main vide
se pétrifie)
Reste à creuser ici
dans la page à vif inciser
l’œillet Une main l’arrime
lanière y tire à l’air
(dans le poème «gabarre»
comme sous verre est trop sage
La lecture lui soit descente
du fleuve vers l’océan)
Puis voile puis haut large
souffle gonfle sans déliter le vent
l’enfant simple y a
ailes et pieds
3
Parfois pendent
sans autre forme
ses peaux de vache
Parfois dans ses peaux
de lourdes pierres
creusent un vide
Lui s’en absente
en l’état
les laisse en forme
Puis un regard
après des ans
pourquoi renoue
Qu’un mot
longtemps lourd en nous
à nouveau fasse et défasse
Ses nœuds à gros traits
dans l’œillet
il les lace
Plante un pieu
puis un autre puis
les amarre
Gorge nouée
l’origine
par ailleurs monte
Dans la parole nouer
mot à mot n’est pas
anodin
Mais lui dans le vent
et la tempête a mis
des enfants
Grimpent roulent tracent
quel fil invisible dans l’air
les libère
Jean-Damien Chéné
Texte : Droits réservés.